NOTRE HISTOIRE AU FIL DES ANS ET DES SAISONS
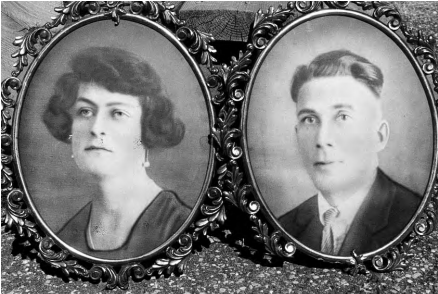
Antoinette et Eugène
Projet de vie commune
Les fréquentations de nos parents furent sans doute des moments tendres, remplis de projets et de promesses. Tous deux venus d’une famille nombreuse, prévoyaient déjà suivre l’exemple de leurs parents. Les tempéraments de notre père et de notre mère étaient tout ce qu’il y a de complémentaires; en effet, Eugène avait un caractère plutôt explosif et fonceur. Il avait la tête pleine de projets et ne cessait de travailler à les réaliser. Notre mère, Antoinette, était dotée d’une nature joyeuse et rieuse. Cela ne lui enlevait pas son sens aigu des responsabilités, mais elle trouvait toujours une façon de dédramatiser les situations les plus tragiques. Il fallait à nos parents ces qualités précieuses, pour traverser une vie qui s’avérerait des plus exigeantes.
Leur mariage eut lieu à Saint-Ulric, le 1er septembre 1926. Un an plus tard, au mois d’août naissait Marcel, leur premier enfant. Le Québec était alors assez prospère suite à l’après-guerre 14-18 et Eugène réussissait, comme journalier, à faire vivre convenablement sa nouvelle petite famille. Jusqu’en 1929, tout allait bien pour le couple Antoinette et Eugène. J’imagine leur bonheur et leur chance de pouvoir vivre près de leurs familles respectives. C’était pour eux un doux printemps, un début prometteur pour leur vie future.
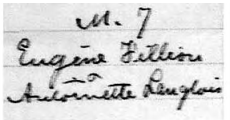

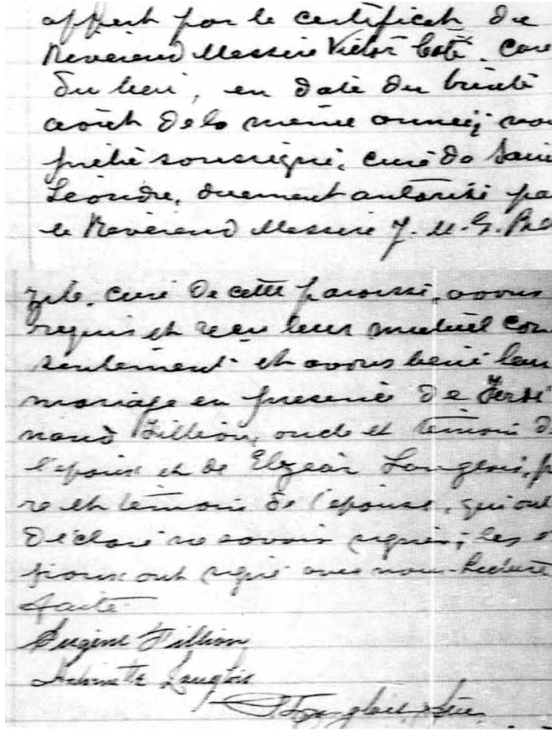
Je
n’oublierai jamais l’avril de mon enfance.
Les enfants le parfum que le printemps murmure je n’oublierai jamais cette douce romance qui montait en mon cœur comme chansons qui furent.
C’était beau, c’était beau à en fendre le cœur après neige fondue, c’était soleil qui brûle.
C’était beau à pleurer de bonheur comme un feu
sous la glace au sang frais de gelure.
Je
n’oublierai jamais l’avril de mon enfance.
Entre ce
mars gelé et le doux lilas.
C’était beau, c’était beau comme un enfant qui naît.
Nous
sortions des cendres pour courir dans l’air frais.
André
Daigneault
La sécurité financière fut de courte durée, car survint le krach de l’année 1929, le pire désastre économique que l’Amérique ait subi. Les gens n’avaient plus aucun moyen de subsistance, ce qui provoquait une multitude de faillites, suicides, pauvreté, enfin, désarroi pour tous, riches comme pauvres. Eugène devait travailler d’une étoile à l’autre pour un dollar, lui permettant, tout juste assez, de subvenir aux besoins des siens.
Le Lac Saint-Jean

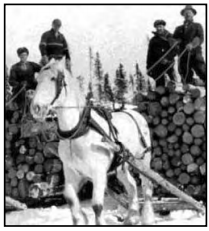
Poussés par le désir d’améliorer leur sort et d’apporter un peu plus de confort à leurs enfants, notre père et notre mère décidèrent d’aller tenter leur chance au Lac Saint-Jean où, semble-t-il, on pouvait se tirer d’affaire dans les chantiers. Pour eux, ce fut là, presque la séparation définitive d’avec nos grands-parents. La distance, le peu de moyens de transport et les faibles revenus ne leur permettaient pas de retourner dans leur famille. Le seul moyen de communiquer était la poste.
Il faut avoir bûché dans les chantiers de ce temps pour se faire une idée du courage déployé par notre père et tous ceux qui exerçaient ce foutu métier. Du lever du jour au coucher du soleil, six jours par semaine, à abattre des arbres, dans toutes les conditions atmosphériques imaginables; pas de temps à perdre, sinon la famille en souffrirait; transporter ces bûches, les corder et attendre les mesureurs chargés de vérifier la quantité de bois coupé; plus souvent qu’autrement, ces mêmes mesureurs refusaient le bois sous prétexte d’une branche mal coupée ou encore, de bûches de quelques centimètres trop courtes ou trop longues; alors, tout était à recommencer. Pensons à l’habillement de ces mêmes bûcherons; leurs vêtements n’étaient pas imperméables comme ceux d’aujourd’hui. Le froid, l’humidité, la neige, la pluie et le vent avaient tôt fait de traverser ces vêtements pour s’attaquer à la santé des travailleurs. Il faut savoir qu’on se rendait dans les chantiers pour plusieurs semaines, sinon plusieurs mois. Les gars appelaient ça une «run». Quelques mots encore sur la salubrité des lieux; impossible de laver son linge; quelques-uns réussissaient tant bien que mal à nettoyer certains morceaux le dimanche, mais l’ensemble conservait les mêmes vêtements pour la durée du chantier. C’est pourquoi, lorsqu’Eugène revenait, toute la maison embaumait le sapin! Heureusement, cette odeur surpassait celles de ses vêtements non lavés pendant des semaines…
Il y avait l’ennui des travailleurs et de leur famille, l’inquiétude et cette hâte quasi incontrôlable de revenir à la maison. À son retour, c’était la fête et la sécurité revenue. Sécurité chèrement gagnée, car les salaires étaient tout ce qu’il y a de plus minables; il fallait s’en contenter ou...
C’est à Saint-Félicien, au Lac Saint-Jean qu’Eugène loue un logement pour sa petite famille qui s’agrandit avec les années. Après Marcel (1927), arrive Osias-Jean-Marie (1929), suivi d’Irène (1930), ensuite, Bertrand (1931) et Jeanine (1934) toute une petite marmaille sous la protection du couple Fillion. Malgré le travail et les difficultés, on réussit tout de même à trouver du bonheur, sans doute à cause de l’amour qui règne dans cette maison.
Un premier fils disparaît
Un jour de l’année 1935, alors qu’Eugène était parti travailler dans les chantiers, Osias-Jean-Marie, six ans, tomba subitement malade, et cela, très gravement. Antoinette, seule, fit l’impossible pour soigner son enfant brûlant de fièvre. La visite du médecin n’y changea rien et en l’espace de quelques heures, notre frère mourut dans les bras de notre mère en pleurs. Il fallut avertir notre père du drame arrivé en son absence. Des voisins, peut-être les responsables de la compagnie pour laquelle il travaillait, réussirent à le rejoindre. C’est à pied, durant plus d’une journée sur plusieurs kilomètres dans la neige, qu’il parcourut le trajet pour venir pleurer son fils et réconforter sa famille. Cet épisode nous dévoile la vie de notre famille, parsemée de courage, de foi et de situations d’une tristesse sans nom. Nous sommes issus de ces valeurs incroyables qu’ont eues nos parents. Cet événement laissa un grand trou dans le cœur de ceux-ci.
Notre père nous relatait, plus tard, les péripéties de cette descente des chantiers, à Saint-Félicien, Mistassini, lors de la mort de notre frère. Il nous raconta comment la majorité des bûcherons d’alors, n’étant pas assez riches pour s’acheter des bottes d’hiver, chaussaient des mocassins de couleur blanche, confectionnés avec de la peau de vache. Confortables et chauds par temps froids et secs, ces mêmes mocassins si utiles pour travailler se changèrent, lors de sa longue marche, en véritables patins, glissant sur la neige humide dans toutes les directions, provoquant de multiples chutes. Chaque pas nécessitait une attention particulière et retardait sa marche qu’il eut voulue plus rapide dans les circonstances.
Au risque de me répéter, aujourd’hui, lorsque je compare la vie pas si lointaine de nos parents et que j’en fais la comparaison avec la nôtre, je ne peux m’empêcher de manifester mon admiration et mon affection pour le courage, la détermination et l’amour démontrés par ceux qui nous ont précédés. Même si je n’actualise pas avec autant d’ardeur les mêmes valeurs que nos parents, je suis fier d’être issu de cette lignée.
La vie au Lac Saint-Jean, même si elle répond aux besoins primaires de la famille Fillion, ne suffit pas aux aspirations d’Eugène et d’Antoinette. Le rêve serait, pour eux, de posséder, comme leurs parents, une terre et de subvenir aux besoins de leurs enfants, dans leur maison, chez eux. Surtout qu’un nouvel enfant, Huguette (1936) s’était ajoutée à la famille.
La liberté, enfin!
Là, je reconnais notre père. C’était un homme épris de liberté et de dignité. Chaque fois qu’il a dû obéir à des règles humiliantes, dégradantes et aliénantes, sa réaction s’est avérée explosive. Mais quand la survie de sa famille était en danger, il pouvait faire taire son ego et courber l’échine. Ce n’était ni de la fierté ni de l’orgueil; on pourrait dire que c’était de la «fiergueil». Trempé dans les valeurs de nos ancêtres, acculé aux choix les plus déchirants, pour Eugène, il n’y avait qu’un choix: se battre et laisser les sentiments de côté, parfois même vis-à-vis de ses enfants. C’était un amour dur, «tuff love», incompréhensible pour plusieurs d’entre nous, mais de l’amour quand même. Je me demande, parfois, ce que j’aurais pu faire de mieux à sa place; je n’ai aucune réponse.
Un nouvel espoir
Le gouvernement provincial, pour aider les familles à surmonter les suites de la grande dépression de l’année 1929, propose à ceux qui le désirent de postuler pour l’obtention de lots à bois et agricoles, afin de leur permettre de survivre, du moins on l’espérait. C’était l’ère de la colonisation. Deux territoires furent ouverts: l’Abitibi et la Côte-Nord. C’étaient de grands espaces vierges, occupés par la forêt, les moustiques et le silence.
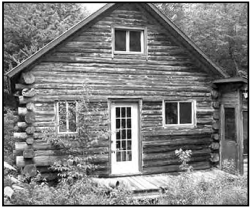
Le choix de nos parents se fixa sur la Côte-Nord. Cette décision fut sans doute motivée par la proximité de la famille des grands-parents, même si un immense fleuve les séparait. C’était toujours mieux que le bout du monde, l’Abitibi. Le ministère de l’Agriculture leur attribua une terre à Sainte-Thérèse de Colombier. Le territoire était alors divisé en rangs; nous nous établirions dans le rang 7. Plein de rêves et de projets fantastiques, voilà toute la maisonnée entraînée dans une aventure dont personne ne connaît l’issue. Ce devait être une joie mêlée d’appréhension qui habitait toute la famille. Quelque chose d’important allait se produire!
En 1938, Eugène partit avec cinq autres futurs colons préparer la place pour leur famille dans ce pays auquel tous rêvaient déjà. Le travail consistait à tracer un chemin à travers la forêt, jusqu’à leur lot respectif, abattre les arbres, les tronçonner afin que le moulin à scie les découpe en planches pouvant servir à construire les maisons. Ces habitations étaient toutes identiques: 22 pieds par 24 pieds, sur un étage et demi; pas de jaloux.
Pendant ces trois mois d’éloignement, Antoinette veillait soigneusement sur sa marmaille. Le gouvernement devait lui prodiguer les subsides nécessaires pour survivre au cours de cette période: chèque qui n’arriva jamais. Elle réussit tout de même à se tirer d’affaire, sans doute avec l’aide de ses bons amis de l’endroit. En effet, Antoinette s’était liée d’une profonde amitié avec ses voisines du Lac Saint-Jean. Cette amitié a duré longtemps après son départ pour la Côte-Nord. Un nom me revient en mémoire: Mme Doré dont elle parlait comme d’une sœur.
Pendant cinq mois, notre père travailla d’arrache-pied à l’aménagement de notre futur lieu de résidence. Puis le grand jour arriva… Il revint au Lac Saint-Jean, chercher sa précieuse famille.
Un voyage épique
J’imagine la nervosité des cinq enfants, l’inquiétude déguisée de maman, et la supervision de papa. Un départ pour une terre inconnue! Que de sentiments contradictoires devant un tel événement! Le plaisir de découvrir un nouveau monde, mêlé à l’appréhension et à la peur de l’inconnu. Cela, non seulement pour les enfants, mais aussi, pour notre mère.
Les meubles et toutes les choses domestiques ainsi que les biens personnels furent empaquetés pour le transport. Une fois cette opération terminée, les familles concernées s’embarquèrent dans un autobus nolisé pour l’occasion, vers l’inconnu. Le départ se fit en soirée et tous s’arrêtèrent à Sainte-Anne de Portneuf, petit village situé à environ trente kilomètres du point d’arrivée. Comme c’était la nuit, tous furent logés à l’hôtel. De là, ne pouvant aller plus loin en autobus puisqu’il n’y avait pas encore de pont sur la rivière Portneuf, ils durent prendre un bateau, qui les amena, en croisière, jusqu’aux Îlets Jérémie. Pas de débarcadère, on s’en doute, et tous durent marcher dans la boue jusqu’au rivage. Les filles ignoraient, à ce moment, les bienfaits de l’argile sur la peau; nous avons compris beaucoup plus tard pourquoi Jeanine avait les jambes si douces!
La maison n’était pas tout à fait prête et la famille dut patienter chez des gens du village, quelques jours encore avant de terminer le voyage six milles plus loin. Deux jours plus tard, tous étaient prêts à entreprendre la dernière étape du voyage, pour ne pas dire, de l’épopée. Il faut imaginer le branle-bas de combat ce matin-là: un tracteur à chenilles remorquant un traîneau les accueillit pour les mener à leur nouvelle demeure. Ce que l’on appelait chemin n’était en réalité qu’une éclaircie à travers les arbres permettant au tracteur de circuler. Le curieux cortège passait devant de petites maisons récemment construites, toutes pareilles, plantées à travers les arbres, comme des champignons égarés dans un milieu inapproprié.
Ce dut être un bonheur indescriptible de rentrer à la maison et de retrouver les meubles qui étaient pour eux leur seule source de référence. L’intérieur de la maison était totalement étranger ainsi que l’extérieur composé exclusivement d’une forêt de conifères. Il ne fallut que peu de temps à chacun, pour découvrir son nouvel environnement: la maison et la grande forêt silencieuse. Quel moment de rapprochement entre Antoinette, Eugène et les enfants, regroupés, la tête remplie de questions face à ce qui les attend et leur fait un peu peur! Ce n’était pas la petite maison dans la prairie, mais plutôt la petite maison perdue dans la forêt.
Chacun pouvait faire la découverte de sa nouvelle vie, dans ce nouvel univers, tandis que la tâche se faisait pressante pour papa et maman. Pour Antoinette, ce fut le rangement, l’installation et la décoration de la maison. Eugène, lui, devait aller au plus pressant: sa première préoccupation fut de couper le bois de chauffage. Comme convenu, il devait s’acquitter de tâches sociales. Entre autres, se joindre à la corvée de construction de l’église située à six milles de sa demeure, matin et soir. Il dut aussi participer à la construction de l’école en bois rond où frères et sœurs ont étudié. Marcel a fréquenté cette école pendant une longue semaine. À onze ans, il en savait déjà plus que la maîtresse, à ce qu’il nous a dit. Je suis porté à le croire, il a toujours appris vite. À cette époque, notre père lui fabriqua une scie, «sciotte» «boxa», plus petit que la normale, trois pieds plutôt que trois pieds et demi, afin qu’il puisse commencer à l’aider à la coupe des arbres.
Lorsqu’Eugène travaillait comme journalier, à l’emploi de particuliers ou de compagnies, avant de venir à Sainte-Thérèse, il commençait ses journées à sept heures du matin pour terminer à six heures le soir. Arrivé à Sainte-Thérèse, il garda le même horaire de travail. Marcel qui s’était transformé en bûcheron avait de la difficulté à le suivre. Il raconte que le «flo» avait souvent la langue longue. Comme les commissions devaient être faites au village, situé à six milles de là, c’est Marcel qui hérita de la tâche de faire l’aller-retour, afin de répondre aux besoins de la famille. Je m’étais toujours demandé pourquoi il était si fort et résistant. Le chanceux, il eut tout un entraînement gratuit. Par la suite, le gouvernement a institué une coopérative chargée d’acheter le bois des colons et de leur construire un magasin. C’est encore Marcel qui a hérité de la tâche d’aller au magasin, transportant gallon de mélasse d’une main, réservoir de combustible de l’autre et le reste dans un sac à dos. Cette aide de son aîné donnait à notre père le temps de dégager les environs de la maison, de repousser la forêt.
Quel ne fut pas le bonheur de notre grand frère lorsqu’aux premières neiges, notre père acheta un chien, construisit un traîneau et confectionna un harnais! Quel luxe! Le chien traînait Marcel jusqu’au village et le ramenait avec plus de cent livres de victuailles. Le vaillant chien devait être aidé dans les côtes. Ce fut le premier moyen de transport de la famille.
Organisation
Il fallut penser aussi à la planification de la ferme: les bâtiments, l’étable, la porcherie, le poulailler, la grange pour entreposer le foin, l’abri pour les outils aratoires et l’organisation du jardin potager.
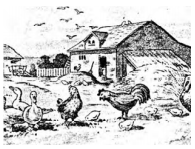
Au début, malgré les idées bien conçues de notre père sur la localisation des bâtiments de ferme, l’avoir financier l’obligea à restreindre ses projets de construction. Il décida de se limiter à une seule construction, qui abriterait sous le même toit tous ses animaux: vache, cheval, poules, et même cochons. C’était une construction au toit en pente; en planifiant bien l’espace, elle pourrait recevoir tout le cheptel. Le fait de la proximité des animaux, serrés les uns contre les autres, produirait assez de chaleur au cours de l’hiver. L’extérieur était composé de bardeaux peints à la chaux, percé de minuscules fenêtres permettant à la lumière de s’infiltrer. Ensuite, il décida de construire un hangar qui abriterait les outils, le bois de chauffage et permettrait de procéder au travail du bois. Ces deux bâtisses formaient, avec la maison, un ensemble déterminant déjà le contour de la cour intérieure. La maison s’alignait avec le chemin, le hangar couvrait la partie gauche de la cour, alors que l’étable provisoire se dressait vers la droite. Le plan était, bien sûr, de construire plus tard une grange étable complétant cette cour intérieure.
Pendant tout ce temps, il fallait défricher, arracher les souches des arbres coupés, les brûler, extirper les racines et préparer la terre à recevoir les premières semences. En ce temps là, selon Marcel, le ministère de l’Agriculture offrait une aide pour essoucher seulement et le cultivateur devait faire le reste. Il n’y avait qu’un seul tracteur et chacun devait attendre son tour.
Petit à petit, la forêt fit place aux champs, et la terre se mit à produire. La maison faisait face à ce que l’on appelait, alors, une montagne. C’était plutôt une élévation sommaire de pierre et de terre infertile; juste bon pour ramasser des bleuets et encore... C’est là que se trouvait le cran, témoin de toute notre vie. De chaque côté s’étendaient les champs, jusqu’aux limites des terres des voisins; François Charron, à gauche, Adélard Ouellet, à droite. À la limite arrière de la maison s’élevait une autre montagne. Si l’on compare la terre paternelle à celles d’aujourd’hui, on pourrait dire que la vraie partie cultivable était minuscule et sans importance pour un cultivateur moderne. Et pourtant, malgré son infime superficie, elle répondait à tous les espoirs de nos parents et presque miraculeusement, comblait tous nos besoins de vie et de survie. Ce miracle était sans doute dû à l’amour de nos parents, se manifestant par une attention constante à nos besoins et à leur travail inlassable pour y arriver. Le miracle, nous le sommes dans ce que nous sommes devenus.
Au cours de ce temps, Lucette (1939) et Colette (1940) sont venues enrichir la famille Fillion de leur présence. Dans mes souvenirs, ces deux sœurs sont toujours restées proches l’une de l’autre. Quelle belle complicité, dans leur vie d’enfant, et même dans leur vie d’adulte! Leur tempérament se complétait à merveille: Colette fonçait, toujours prête à relever des défis, tandis que Lucette était plutôt rêveuse, d’une joie intérieure surprenante et invitante. Elle représentait l’eau alors que Colette, c’était le feu.
Autour des années 40, le projet d’Eugène et d’Antoinette se réalisait et la sécurité physique et psychologique de tout leur petit monde était assurée. Peut-être au coût de bien des peines, mais c’était certainement le bonheur pour nos parents de voir toute la maisonnée vivante et pleine de promesses. Nos parents étaient conscients de leur rôle, sachant qu’il ne finirait qu’avec l’épanouissement de tous leurs enfants, ils faisaient l’impossible pour l’accomplir.
Irène avait alors onze ans, Jeanine neuf ans et déjà elles tenaient une place importante dans les tâches domestiques, apportant une aide indispensable à notre mère. Pour leur part, Marcel et Bertrand devenaient de plus en plus utiles face aux travaux à accomplir sur la ferme. Marcel, même s’il n’avait que treize ans, possédait déjà la force d’un homme, à ce que me disait Bertrand. Celui-ci me racontait en riant que, lorsque Marcel et lui coupaient du bois, l’un et l’autre à chaque bout de la scie à main, la «sciotte», Marcel ne faisait pas que manier la scie, il manœuvrait Bertrand aussi. Notre père travaillait dans les chantiers l’hiver et sur la ferme l’été. Marcel le suivait et faisait l’expérience de la vie économique du temps.
L’école du rang accueillait toute la marmaille et la vie devenait de plus en plus rythmée et sécurisante pour tous.
Plusieurs d’entre vous, et surtout moi-même, doivent se demander pourquoi j’ai tant tardé à naître. Après m’être posé la question, j’en suis venu à la conclusion que j’ai choisi de naître quand le gros de l’ouvrage serait terminé! Je devais être, déjà, un peu paresseux… Grand veau dirait maman!
L’année 1942 fut déterminante dans ma vie, puisque c’est l’année où je vis le jour… le neuvième enfant de la famille. Après quatre filles, mes parents ne se souvenaient sans doute plus du bonheur de voir apparaître un garçon. J’étais bien prêt à partager leur bonheur, mais je vous jure ne me souvenir de rien. Pour mes sœurs, j’étais un bébé braillard et toujours malade, mais il semble que j’étais un bien beau petit! Mes premières années furent assurément du même type que pour les autres frères et sœurs: entouré des soins de notre mère et dorloté par mes sœurs quand je ne pleurais pas.
Quel drame!
L’année 1943 fut dramatique pour toute notre famille. Irène, l’aînée des filles et ma marraine, alors âgée de treize ans, fut subitement atteinte d’une maladie très grave le 12 mars 1943. D’abord, ce fut un mal intense à une jambe. Il n’existait pas de médecin dans la paroisse en ces temps-là. Le gouvernement assignait une garde-malade qui veillait alors à assurer les soins primaires des citoyens. La première fois qu’on la fit venir, elle prodigua au mieux de sa connaissance, les soins appropriés et comme le lendemain le mal empirait dangereusement, on décida, d’un commun accord, de l’envoyer à l’hôpital le plus proche, celui de Rimouski, de l’autre côté du fleuve. Elle communiqua avec l’hôpital et par télégramme, nolisa un avion pour dix heures le lendemain avant-midi, le 18 mars, sur le banc des Blancs à la sortie de la rivière Bersimis. Le Banc des Blancs était un banc de sable accumulé à la sortie de la plus grande rivière de la région. Cet endroit se trouvait à environ 18 milles de la maison et servait de piste d’atterrissage d’urgence.
C’est avec une grande tristesse que notre mère et les plus vieux des enfants virent partir Eugène, à quatre heures du matin, seul, avec son cheval et notre sœur malade, pour la mener à l’avion. Un petit avion sur skis arriva à l’heure prévue. Eugène fut le dernier à voir Irène vivante, et ce fut pour elle le premier et le dernier voyage de sa jeune vie. Sans nouvelle de leur fille pendant plus de quinze jours, nos parents reçurent une lettre des religieuses responsables de l’hôpital leur annonçant qu’Irène était morte le dimanche 28 mars 1943, des rhumatismes inflammatoires. On l’avait enterrée dans le cimetière de l’hôpital Saint-Joseph de Rimouski et on ne la reverrait jamais. C’était ma marraine. Un service fut chanté à l’église de Sainte-Thérèse de Colombier, le 3 avril.
L’inquiétude mêlée d’espoir de toute la famille se transforma, ce jour-là, en une détresse indescriptible. Juste de penser qu’Irène était allée mourir, seule, loin des siens, sans aucun réconfort, de s’imaginer la détresse de cette enfant coupée des liens affectueux et rassurants de sa famille, a dû crever le cœur de nos parents et des autres. La mort les avait séparés, mais l’amour qui les avait unis, j’en suis convaincu, dure encore après tant d’années. Après la mort de Osias-Jean-Marie, ce fut le deuxième grand trou au cœur d’Eugène et d’Antoinette.
Comment mettre un visage sur une personne qui a, pour un temps, tenu une place si importante au sein de notre famille? J’ai demandé à Jeanine de me décrire notre sœur. Il semble qu’elle était grande, mince, les cheveux châtains et qu’elle ressemblait étrangement à Denise. Elle était d’un caractère doux et serviable. Jeanine la trouvait très belle. Ce sont les seules informations que je possède d’elle; ces informations sont suffisantes pour regretter de ne pas l’avoir connue. Maman dirait: «Un ange de plus au paradis».
Une photo d’elle à sa première communion m’est parvenue comme par miracle. La voici...

La religion et la vie du temps
C’est incroyable, quand j’y pense, à quel point le ciel, l’enfer et toutes les croyances religieuses prenaient place et influençaient la totalité de la vie en ces temps là. Notre mère, en plus d’empiler les revues de la bonne Sainte-Anne sous son matelas, nous conviait chaque jour, c’était obligatoire, à la prière du soir se composant d’un chapelet, des différents actes, de foi: d’espérance, de charité, de contrition, etc. Cette prière s’étirait d’une litanie interminable et tout cela, à genoux. Tous devaient y être et y participer. Le culte d’Antoinette était surtout centré sur la bonne Sainte-Anne et sur Sainte-Thérèse. Chaque année, au mois d’août, elle allait faire un pèlerinage organisé, dans les environs, accompagnée de notre père et de Marcel. Ajoutons à tout cela, la messe du dimanche, la messe de minuit, le carême, Pâques, et toutes les fêtes du calendrier.
Notre année était modulée par tout ce qui était du domaine liturgique et cela faisait partie de nos valeurs prioritaires.
Mon premier voyage en «buggy», genre de calèche tirée par un cheval, fut pour me rendre à l’église, à la messe. C’était un rituel que de prendre ce moyen de transport, chaque dimanche, pour aller prier et surtout manger les bonbons achetés au genre de dépanneur qui n’avait rien en commun avec ceux d’aujourd’hui. Ce lieu servait de stationnement aux chevaux pendant la cérémonie dominicale. En hiver, c’était la carriole, accompagnée de la musique des grelots, qui nous faisait faire le même trajet et répéter le même cérémonial.
Toutes ces cérémonies s’intégraient à notre vie et auraient peut-être été moins bien acceptées s’il n’y avait eu Noël avec ses cadeaux et ses festivités, Pâques avec ses chocolats, la Sainte-Catherine avec sa tire, la Mi-Carême avec ses visites-surprises, la Saint-Jean et j’en oublie sans doute beaucoup d’autres.
Nos parents étaient animés d’une foi et d’une ferveur immense leur donnant, certainement, le courage et la ténacité que nous leur avons toujours connus. On dit souvent de certaines situations qu’elles tiennent du miracle. Alors, je crois que même si nos parents étaient des humains, avec leurs qualités et défauts, ils n’auraient pas aussi bien réussi leur mission s’ils n’avaient été croyants. Ces valeurs spirituelles ont été la base morale de l’éducation reçue et le moteur de leurs décisions nous concernant. Leur réussite tient un peu beaucoup du miracle. Serions-nous ce miracle?
Le curé prenait une place très importante dans la vie du temps. On n’aurait jamais osé le contredire ou désavouer une seule de ses paroles ou un seul de ses gestes. C’était l’homme de Dieu et on le mettait sur un piédestal, un saint homme quoi. Je me rappelle l’aspect théâtral de ses gestes et de son langage lorsqu’il montait en chaire. Il pouvait, dans le même sermon, projeter l’assemblée en enfer, la retourner au ciel et la faire retomber dans la réalité. La peur, la joie, la culpabilité, toute la gamme des émotions y passait. Il connaissait tout de ses paroissiens, la confession aidant, et il pouvait à l’occasion faire pression de façon efficace. Il avait même le contrôle des naissances. C’est lui qui en vérifiait le rythme et pouvait, plus souvent qu’autrement, pousser les époux à faire diligence pour se remettre à la tâche et faire un autre enfant. Sinon, péché! Nos parents ont été très dociles si l’on considère le nombre d’enfants mis au monde. Merci à nos parents et aussi au curé si nous sommes de ce monde. Baptême, première communion, confession, confirmation étaient tous des étapes très importantes, des passages obligés pour aller au ciel!
Qu’à cela ne tienne, les sorties dominicales n’avaient pas seulement un effet spirituel, elles avaient, aussi, une influence sociale primordiale. En effet, elles permettaient aux paroissiens de se rencontrer, d’échanger les dernières nouvelles, de transiger selon le cas, de fixer des rendez-vous de travail ou encore des rencontres amicales. On réglait, sur le parvis de l’église, beaucoup de choses, car toute la paroisse y était présente.
Au fond, en ce temps-là, Dieu était-il plus important que le curé?
La visite du curé
Une fois annuellement, le curé du village faisait la visite de ses paroissiens, non seulement pour saluer ses ouailles, mais aussi pour donner ses commentaires et les inciter à la prière, la pénitence et surtout, à suivre les commandements de l’Église, c’est-à-dire payer la dîme annuellement et favoriser la naissance des enfants, sous peine de péché mortel. Il en va de même pour l’obligation d’assister à la messe dominicale et la nécessité de recevoir régulièrement les sacrements de Pénitence et d’Eucharistie.
Pour cette visite, la maison devait être nettoyée de fond en comble. Nous-mêmes, nous passions sous le «clipper», la débarbouillette et parfois la brosse à plancher. Tout et tous devaient être parfaits.
On ouvrait le salon spécialement pour l’occasion et on nous avertissait d’être polis et tranquilles. Ce n’était pas dit ouvertement, mais on savait intuitivement qu’il fallait paraître le plus saint possible.
Arrivait enfin la visite tant attendue ou redoutée, «LE CURÉ». D’une démarche lente, presque étudiée, il montait les marches du perron, et ne frappait pas à la porte, puisque maman l’avait déjà devancé. Tous, nous retenions notre souffle, comme si le bon Dieu avait fait son entrée. Nous ne savions pas quelle attitude prendre. Une fois assis au salon, il daignait enfin nous regarder et prendre note de notre présence. Après, il passait aux choses sérieuses avec notre mère. Au bout d’une demi-heure, tout était terminé, et nous retournions à nos vêtements de semaine.
Cette visite prenait une importance exagérée et nous n’en comprenions pas la raison. Aujourd’hui, nous sommes en mesure de comprendre à quel point la religion et ses représentants prenaient une si grande place dans la vie de nos parents. Pour eux, le curé représentait Dieu et peut-être en avaient-ils un peu peur. C’était l’homme le plus influent de la paroisse et il se comportait comme tel.
Avant son départ, il n’oubliait pas de donner ostentatoirement quelques médailles à Antoinette, lui faisant bien comprendre la valeur de ce présent. Enfin, il nous faisait mettre à genoux et d’un geste magistral, levant les bras au ciel, nous bénissait d’une voix ronflante et pleine de ronronnements. Nous ne pouvions pas nous empêcher d’être impressionnés par une telle mise en scène. Nous comprendrions, beaucoup plus tard, le pourquoi de ces cérémonials…
La visite
Malgré le bout du monde où nous habitions, des membres de la famille, oncles et tantes, réussissaient à nous retrouver. Quelques-uns habitaient sur la Côte-Nord, ce qui leur permettait de venir nous voir plus souvent, si l’on peut parler ainsi.
Il y avait notre oncle Gustave, frère de maman, demeurant lui aussi à Sainte-Thérèse, à l’autre bout du rang 7. Les yeux bleus, le visage rieur, toujours de bonne humeur, il mettait de la joie autour de lui. Il venait presque toujours accompagné de son épouse, Lucienne, et de ses deux seuls enfants, Bruno et Rosette. Maman ne faisait pas beaucoup de cérémonies lorsqu’ils se présentaient, puisqu’elle les considérait comme de la famille. À quelques reprises, dans l’année, nous les voyions arriver et c’était toujours la fête. Son moyen de transport était un simple chariot attelé à un cheval de trait. Il n’avait pas notre richesse…, nous possédions un buggy et un cheval de course… «réflexions d’enfants». Je vois en cet oncle un genre d’artiste. Il ne s’en faisait guère avec la vie et il se concentrait plus sur le bonheur des siens que sur la prospérité. En un mot, il était plus décontracté, état que notre père ne connaissait pas souvent. Pour nous, c’était la lutte continuelle.
Tante Irène, sœur de maman, demeurait à Hauterive et était mariée à Prudent Lechasseur. C’est drôle comme les frères et sœurs de maman avaient le même caractère. Tous étaient doués pour dédramatiser la vie et s’amuser même des pires tragédies. Irène était, elle aussi, de cette trempe, et quand les deux sœurs se rencontraient, c’était la rigolade. La famille Lechasseur venait nous visiter au moins une fois l’an, au cours de l’été. Ils avaient six enfants. Tante Irène et tante Eugénie, sœur de papa, de Franklin, connaissant nos besoins, apportaient toujours des boîtes de linge qui pourraient, selon ses dires: «peut-être être utiles» Ces vêtements permettaient à Antoinette de refaire la garde-robe de plusieurs d’entre nous, et lui donnaient l’opportunité de coudre de multiples objets d’utilité. Sans le savoir, tante Irène et tante Eugénie faisaient bien des heureux et maman, avec son talent particulier pour la couture et sa grande débrouillardise, réussissait en un rien de temps à confectionner de véritables petits chefs-d’œuvre.
Imaginez un curé dans la famille! Eh oui! Mon oncle curé Philippe Langlois, ordonné le 21 août 1916, devenu chanoine par la suite, frère de maman, la fierté de nos parents, avait pris l’habitude de nous visiter quelques jours à chaque été. C’était un homme cultivé et rangé; il passait des heures à lire son bréviaire ou à arpenter les environs, posant un regard d’appréciation sur les travaux de notre père. Antoinette faisait tout pour rendre la visite de son frère la plus agréable possible, et Eugène, qui normalement ne se gênait pas pour échapper quelques jurons, retrouvait un langage plus étudié et soigné.

Oncle curé appréciait beaucoup ses visites dans notre royaume et parfois, nous glissait quelques dollars en cachette, sachant très bien que nous les remettrions à nos parents. Sa présence se faisait la plus silencieuse et tranquille possible, tellement, qu’à la fin, nous le considérions comme l’un des nôtres.
Une fois, il y eut des invitées très surprenantes! C’était Marie-Louise, religieuse, sœur de papa, et une de ses compagnes. Cette visite m’a marqué au plus haut point; j’étais sur le cran devant la maison, lorsque j’ai vu débarquer deux personnages habillés de noir, huppés de blanc, gonflés comme des dindons prêts à la bataille. C’était la première fois de ma vie que je voyais un tel accoutrement et j’avais peine à croire qu’il se cachait des humains là-dessous. Ma curiosité m’entraîna vite à la maison où je vis, sous cette montagne de vêtements, deux visages de femmes. Je ne pouvais pas comprendre le pourquoi de cet habillement. J’eus la réponse à mes questions lorsque maman m’apprit que c’étaient des sœurs. J’en avais entendu parler, mais n’en avais jamais vues. Maman nous avait décrit les religieuses en des termes si élogieux que je lui avais exprimé mon grand désir d’en devenir une quand je serai grand... Cette visite m’a fait perdre ma vocation!
Il faut ajouter, après cette présentation un peu humoristique, que la sœur de notre père fut une personne très appréciée dans le milieu religieux de ce temps-là. En effet, elle avait une spiritualité enviable dans son foyer de prière. Dès son jeune âge, nos grands-parents devinaient déjà chez elle une foi débordante et une ferveur peu commune pour une fillette. Cette profondeur spirituelle ne s’est jamais démentie. Elle s’est jointe à la communauté des religieuses du Bon Pasteur de Québec, sous le nom de sœur Marie-de-Saint-Joseph-de-la-Sainte-Famille. Elle prononça ses vœux définitifs le 10 juillet 1906. Par la suite, elle enseigna pendant onze ans. Elle occupa aussi, humblement, différentes fonctions auprès de sa communauté, qui, selon elle, la rapprochaient de son Dieu. Elle continuera à développer sa vie intérieure et sa relation spéciale avec Dieu, à travers de plus en plus grandes responsabilités.
Elle célèbre son Jubilée de Diamant, le 23 mai 1966, en présence de toute sa famille, qu’elle revoit avec une grande émotion. Après une longue maladie, elle s’éteindra le 21 novembre 1966, entourée de tous les êtres aimés qui lui rendirent un vibrant hommage. Sa filleule Georgianna, aussi sœur d’Eugène, l’assista au cours de ses derniers moments.
« Nos souvenirs sont ce que nous sommes. »
Nikos Kasansaki
Des visages familiers
Du plus loin que je me souvienne, des visages importants surgissent: bien sûr, ceux de nos parents furent les premiers à imprégner nos souvenirs. Jeanine et Huguette ont pris une place importante dans nos vies puisqu’elles aidaient beaucoup Antoinette dans les soins à donner aux plus jeunes enfants. Bertrand, qui avait à l’époque onze ou douze ans, veillait sur moi, surtout la nuit, puisque nous dormions ensemble. Je me souviens qu’à plusieurs reprises, il dut me consoler et apaiser mes peurs. Dans tous ces souvenirs emmêlés, certains nous marquent plus que d’autres. L’un d’entre eux est ce moment de la journée, l’après-midi peut-être, où notre mère, assise dans la chaise berçante, nous prenait Madeleine et moi, en chantonnant La Poulette grise. Je l’ai vue refaire ce geste à de multiples reprises avec tous les plus jeunes.
La maison
Lors de ma petite enfance, je me souviens, nous étions très proches les uns des autres, dans la chaleur et la sécurité de la petite maison qui nous avait complètement conquis. Le rez-de-chaussée était occupé par la chambre de nos parents, la cuisine, où trônait l’immense poêle à bois Bélanger, répandant sa chaleur en plus de cuire les bons plats de maman, qui était excellente cuisinière. La grande table, capable d’accueillir au moins quinze personnes, était entourée de nombreuses chaises et, au bout, un banc que j’ai occupé toute mon enfance. À l’autre bout, s’assoyait notre père et à côté de lui, notre mère; de chaque côté, on y allait par grandeur.
Cela prenait un temps fou à servir tout ce petit monde. Les plus jeunes étaient servis les derniers et avaient toujours peur d’en manquer, ce qui n’arrivait jamais bien entendu. Je revois aussi notre père buvant son thé dans sa soucoupe. Peut-être était-ce une façon de le refroidir. La maison s’enorgueillissait d’un salon; espace réservé, meublé de rotin et décoré de façon spéciale pour la visite. Nous n’avions accès à cette pièce que lorsque se présentaient des occasions spéciales; la visite du curé, les oncles et les tantes de passage, ou tout autre évènement spécial. La porte du salon restait toujours fermée. L’hiver, le froid y était intense. Mon père y entreposait le baril de pommes et elles restaient fermes toute la saison.
Au mur en face du poêle, étaient accrochées les armoires; faites à la main par papa, elles étaient de couleurs éclatantes, jaune et rouge, donnant de la vie à toute la cuisine. Derrière ces armoires s’élevait la cheminée. Un escalier conduisait au deuxième étage, où l’on retrouvait quatre chambres logeant les enfants. La première à gauche était celle des jeunes garçons: Michel, Yvon, Jean-Marie et moi. Que de plaisir nous avons eu à bondir de la commode sur le matelas, en silence, sans nous faire prendre! Juste en face étaient logées les plus jeunes filles: Lise, Denise, Mado, Colette et Lucette. La chambre du fond à droite, accueillait les grandes: Huguette et Jeanine. Enfin, à gauche, au fond du couloir, celle de Marcel et Bertrand.
Eugène avait recouvert les murs du deuxième étage avec de la planche de finition, donnant à nos espaces un petit air vieillot et confortable. Il n’était pas question de flâner à l’étage, cet endroit était destiné au sommeil.
Il faut ajouter à l’ameublement du deuxième les «latrines». Un récipient muni d’un couvercle (heureusement) et assez grand pour contenir la totalité des surplus humains nocturnes. Cette chose était réservée aux filles et aux plus jeunes. Il y avait un chanceux, désigné pour vider cet instrument de soulagement pour les unes, mais de dépit pour ceux qui avaient écopé de la tâche, pour ne pas dire punition de la vidange! Bertrand fut le premier et moi, quand je fus prêt, je pris la relève. Imaginez, à chaque jour! Un jour que je me préparais à accomplir ce devoir, pour ne pas dire cette obligation, la chicane éclata entre Colette et moi. Elle se réfugia en haut de l’escalier et pour se défendre, elle me lança les latrines avec tout ce qu’il y avait dedans. Je vous prie de me croire, ce n’était pas de l’eau bénite. Du coup, je perdis toute ma colère et fus passé au nettoyage. Le pire, elle n’a même pas été punie. Elle a dû faire croire à maman que j’étais le coupable. Elle a toujours été gripette!
J’oubliais de mentionner; la cuisine était ornée d’une horloge dont la base s’avérait être un genre de classeur à courrier, d’un crucifix et d’une photo de Sainte-Thérèse.
Sur la partie arrière de la maison, il y avait l’évier surmonté de la pompe à bras, et dans un coin spécialement aménagé, la laveuse à gaz, le seul instrument mécanique de la maison. Cet instrument ressemblait à un baril blanc, sur ses pattes, surmonté d’une partie contenant deux rouleaux pour essorer le linge: le tordeur. On avait perforé le mur le plus proche afin de sortir le tuyau d’échappement laissant fuir la pollution au-dehors. Avant la venue salvatrice de ce joyau, la lessive se faisait à la main, dans une cuve à l’aide d’une planche à laver. J’oubliais de mentionner qu’une pédale servait à démarrer le moteur. Antoinette, parfois, devait s’activer la jambe longtemps, lorsque la bougie faisait défaut!
Pour terminer, la maison reposait sur une cave de terre, où étaient rangés les légumes; dans cet endroit, frais et sans lumière, ils se conservaient plus longtemps. On y accédait par une trappe munie d’un anneau.
En 1943, à son habitude, maman mit au monde un autre enfant, Madeleine. Suivit, l’année suivante, Jean-Marie (1944), et, ensuite Yvon (1946). Viendront un peu plus tard, Lise et Denise (1948) et enfin Michel (1949). Je devais alors avoir cinq ans et je me préparais, si l’on peut dire, à aller à l’école. En juin 1948, je fus amené à l’école pour m’initier à la rentrée de septembre. C’est au début de cet été-là qu’Eugène décida de terminer la construction des bâtiments projetés. Il construisit avec l’aide de voisins la grange étable dont il rêvait depuis son arrivée. Mes souvenirs d’enfant me font revoir une immense construction qui, une fois achevée, possédait un toit de tôle brillant comme un miroir, des murs blanchis à la chaux, deux grandes portes battantes pour la grange et une plus petite pour l’étable. Nous n’avions jamais rien vu de si beau dans toute la région. Sur le pignon, une girouette en forme de cheval indiquait la direction du vent.
La médaille de bronze du mérite agricole
En 1950, le gouvernement décida d’émettre des médailles au mérite du défricheur aux meilleurs colons qui avaient décidé, douze années plus tôt, de s’établir sur les terres offertes à la colonisation. Il y avait trois catégories pour le concours: celle pour l’obtention de la médaille d’or ensuite suivait le concours pour la médaille d’argent, puis celle de la médaille de bronze. Notre père se qualifia pour le concours de la médaille de bronze. Les critères, pour obtenir cette distinction, étaient au nombre de huit, sur lesquels on attribuait un certain nombre de points. Les évaluations des aspects de la ferme étaient: les constructions, l’outillage, le cheptel, le système d’exploitation, le défrichement, le potager, et il y avait, aussi, un autre aspect se retrouvant dans la section divers.
Sur un total de 1 000 points, Eugène en a accumulé 853. Onzième de sa catégorie, il avait raison d’être fier de sa réussite, malgré toutes les épreuves qu’il avait subies. Cette médaille valait de l’or à ses yeux. Son travail était reconnu et c’était imprimé dans la parution du Mérite du Défricheur, revue publiée par le gouvernement. Dans cette revue on disait:
«
«Si l’on veut soutenir que la vie paysanne constitue un climat favorable aux familles nombreuses, on n’a pas à chercher d’exemple ailleurs que chez M. Eugène Fillion, car ce défricheur est père de treize enfants vivants et la mort en a ravi deux autres.
Établi depuis 1938, M. Fillion a défriché 23 acres de terre qui toutes sont en labour. C’est dire qu’il a travaillé, mais son labeur a été récompensé, car déjà il a une belle entreprise.
Le programme de culture est bon. Il y avait à signaler la très belle apparence du foin et des pommes de terre lors de la visite des juges; l’avoine avait souffert d’humidité, mais les parcs étaient plantureux.
Le clôturage est adéquat. Il reste des roches dans les champs, mais M. Fillion les enlève à l’aide de son bélier mécanique.
Les constructions sont moyennes.
Le cheptel est formé de deux chevaux, une vache, une génisse, un veau, un porc. On garde aussi 20 poules et 25 poulettes. Cela est tout de même suffisant.
Le potager est de qualité.
La comptabilité est assez bonne et l’on pèse occasionnellement le lait.
On conçoit que la tâche d’élever treize enfants ne permette pas à Mme Fillion de s’adonner comme elle le voudrait aux travaux d’arts domestiques, mais elle porte néanmoins une grande attention à la mise en conserve.»
On conçoit la fierté de notre père recevant sa médaille. Je suis certain que ce jour-là, il eut une pensée de reconnaissance extrême envers ses parents, d’avoir orienté son choix vers le métier d’agriculteur, ainsi qu’envers son épouse et ses enfants l’ayant toujours secondé.
Nos saisons
Vers l’âge de six ans, je commence à découvrir les habitudes de la maisonnée. En effet, je pris conscience du jardin. Peut-être parce que j’ai été mis à contribution, comme les autres, pour l’arroser. Le jardin, quelle histoire! Les grains étaient fournis par le ministère de l’Agriculture au cours de l’hiver. En mars, il fallait faire les semences dans des contenants, la plupart du temps des boîtes de conserve, dans la maison. Pendant la germination des graines, mon père confectionnait une couche chaude, du côté sud de la maison, avec du fumier de cheval, le tout recouvert de fenêtres. Ces boîtes extérieures devaient être très étanches, à cause du froid. Lorsque les plans devenaient assez solides, il transplantait le tout dans cette grande boîte vitrée. Le fumier gardait la terre chaude et la lumière du soleil permettait aux plantes de grandir. En juin, tout (petits pois, fèves, choux, navets, carottes, betteraves, radis, oignons, rhubarbe, et même les citrouilles qui n’ont jamais donné de résultats) se retrouvait dans l’espace réservé à la vie de la famille: le jardin. Cette année-là, je fus convié avec tous les plus vieux à arroser le potager. Maman en tête, telle une couvée de jeunes poussins, nous entrions dans le jardin avec une boîte de conserve dont le fond avait été troué à plusieurs endroits pour faciliter l’arrosage de chaque plan. Un baril d’eau nous attendait et cela prenait un temps et une précaution inouïs à exécuter. Quel bonheur les journées de pluie! Quelques semaines plus tard, une autre corvée nous attendait. Encore guidés par notre mère, il fallait commencer le désherbage. Pour cette opération, nous devions apprendre à reconnaître les mauvaises herbes des légumes.
Je crois avoir arraché par mégarde quelques carottes dans mon empressement à bien faire. Tout au cours de l’été, la maisonnée était consciente de l’importance du jardin et chacun se faisait un devoir de faire sa part. C’était là un beau travail collectif.
Les fraises d’Eugène
Je m’en voudrais d’oublier les fraises d’Eugène. Il avait décidé de cultiver des fraises. Il en avait semé à deux endroits. Des espaces assez grands pour une production en vue de faire de la confiture et pour vendre à des clients du village. Nous étions invités à travailler à cette production seulement au début de la saison. Quand les fraises étaient rouges, Eugène se mettait en travers de la route de quiconque aurait voulu se régaler dans son champ de fraises. Imaginez, quinze affamés dans ce petit carré de fruits; adieu, confiture et commerce! Nous en étions conscients et nous l’acceptions volontiers, ce qui ne nous empêchait pas de temps en temps de tendre le bras au travers de la clôture!
Vive la liberté!
Cet été-là, je me suis rendu compte que dès l’école terminée, on faisait voler les chaussures et l’on passait l’été pieds nus. Au début, les petits cailloux pouvaient nous déranger, mais au bout d’un certain temps, nous allions partout, sans nous soucier de l’état du terrain. Il nous est tous arrivé de marcher sur un clou et de devoir l’arracher nous-mêmes. Quelques minutes de boitillement et nous voilà de nouveau repartis à courir dans les champs. Notre territoire n’avait pas de limite. Nous découvrions la nature avec avidité, enivrés des parfums, des goûts, des sons et de la liberté retrouvée. J’ai appris très vite à trouver les framboises, les «calicocos», les bleuets et les quelques fraises des champs pour me régaler. Mes frères et sœurs faisaient mon éducation à cet égard, indiquant les fruits à éviter.
Les foins
Juillet passait très vite, le jardin devenait chargé de verdure et la chaleur aidant, le foin grandissait et mûrissait dans les prés. Le temps des foins était arrivé. On sortait la faucheuse, les couteaux aiguisés soigneusement, on attelait le cheval le plus docile et les champs se mettaient à vivre.
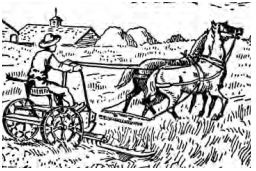

Nous étions fascinés de voir les tiges blondes se coucher lentement à chaque passage de la faucheuse. Pendant ce temps, Marcel et Bertrand fauchaient les endroits difficiles d’accès avec la faux manuelle. En une journée, les champs avaient perdu leur beauté. Tant qu’à moi, on aurait pu les laisser comme ils étaient; c’était bien plus beau. Le lendemain, vers midi, on sortait le râteau et cette fois, le conducteur, en appuyant sur une pédale à intervalle régulier, ramassait le foin en rouleaux d’un bout à l’autre du champ. Une fois cette opération terminée, avec de grandes fourches, on montait des «vailloches», monticules de foin, afin de les sécher au soleil. Le lendemain, la charrette, traînée par un cheval, parcourait la prairie et les ramassait. Nous étions tous émerveillés de voir à quelle hauteur on pouvait charger la charrette, dans laquelle on avait désigné un fouleur, celui qui répartirait la charge et la foulerait avec ses pieds pour en transporter le plus possible. Engrangée, cette nourriture précieuse servait aux animaux au cours de l’hiver. Le soleil, le chant des cigales, tout était beau. Nous, les jeunes, avions un plaisir fou à jouer dans le foin remisé, soit dans la tasserie, pleine à craquer, ou sur le fenil.
Nous étions heureux dans cette atmosphère campagnarde et avions l’impression d’être seuls au monde.
La pêche
C’est à ce moment-là aussi que nous découvrîmes le ruisseau du voisin, François Charron. Pour nous enfants, c’était un fleuve. Aujourd’hui, on considérerait ce cours d’eau comme un vulgaire fossé. Cependant, il était d’une importance capitale pour nous; il y avait du poisson. De minuscules truites, mais c’étaient des truites. À combien d’occasions, Jean-Marie, Yvon et moi nous sommes-nous rendus en bas de la côte du voisin, armés d’une branche d’aulne à laquelle nous avions attaché une ficelle blanche, au bout de laquelle était suspendu un boulon en guise de pesée et pour finir, une épingle à couche recourbée comme hameçon! C’est ainsi que nous nous présentions au bord de ce cours d’eau, fiers de notre attirail.
Là, avec toutes les précautions du monde, un lambeau de lard salé comme appât, nous descendions lentement notre arsenal dans les endroits les plus profonds et sombres; dix pouces de profondeur maximum. Il arrivait parfois qu’un petit éclair argenté se précipitait et s’agrippait à notre hameçon de fortune. Quelle était notre fierté de revenir à la maison avec deux ou trois de ces monstres, applaudis par notre mère qui nous les apprêtait pour le repas suivant! C’est là, je crois, que ces expériences heureuses ont permis à quelques-uns d’entre nous de développer un goût sans équivoque pour la pêche.
Les bleuets
La famille Fillion n’était pas à court d’idées afin de trouver les ressources nécessaires à sa survie; l’une d’elles était la cueillette des bleuets. C’est, vers mes six ans qu’on m’initia à cette activité familiale. Au milieu du mois d’août, ces merveilleuses petites baies se mettaient à mûrir dans la montagne. Déjà, à cette époque, on commercialisait ces petits fruits, ce qui rapportait un certain revenu. C’est pourquoi, à l’approche de cette saison, on s’affairait à terminer tous les travaux pour se concentrer strictement sur la cueillette. Toute la famille était mobilisée dans cette corvée collective. Tous étaient conscients du retour imminent à l’école et de l’urgent besoin de nouveaux vêtements et d’effets scolaires, donc à l’ouvrage. La montagne située en face de la maison servait surtout à la cueillette pour la cuisine. Maman avait la recette idéale pour préparer des «chiards aux bleuets» qui nous font encore saliver après cinquante ans. La montagne derrière, générait beaucoup plus de bleuets, et c’est là que nous allions les ramasser pour la vente. Un lunch était préparé le matin même et accompagnés de notre père, on suivait le long sentier menant à cette montagne qui demeurait pour nous, mystérieuse le reste de l’année à cause de la distance. Le feu avait ravagé la forêt quelques années plus tôt et les seuls arbres restés debout ressemblaient à des squelettes dans un désert de pierre et de mousse. Nous étions peut-être cinq ou six à accompagner papa menant la cueillette. Les bleuets, débarrassés des feuilles et des fruits non mûris, étaient vidés dans des boîtes de bois clouées soigneusement. On exigeait une qualité de fruits irréprochable: aucun bleuet vert, aucune feuille et de plus, aucune trace d’humidité entourant les fruits, n’étaient tolérés. À la vente, chaque boîte était ouverte et inspectée. Si elle ne correspondait pas aux exigences, elle devenait de la confiture.
Pendant quinze jours, Marcel, Huguette, Lucette, Colette, Bertrand, Eugène et moi tenant lieu de mascotte, ramassions cette manne qui nous permettrait de boucler le budget. Nous étions toujours surpris, au retour, de voir Marcel qui, après avoir empilé une quantité incroyable de boîtes pleines et liées ensemble, se les cordait sur les épaules pour les rapporter à la maison. Au retour, c’était la fête. Un bon repas nous attendait et nous retrouvions le calme de la maison si apprécié de tous. J’oubliais de mentionner la caractéristique particulière des cueilleurs de bleuets… C’était le tour de la bouche… Chacun, y compris notre père, revenait le soir, les lèvres, quasiment jusqu’en dessous du nez, d’un bleu sans équivoque: on avait goûté aux fruits plus d’une fois dans la journée. Je me rappelle le bon goût, un délice à volonté! Ces activités familiales avaient un effet de rapprochement entre nous et notre père, nous apportant une satisfaction et une complicité inhabituelles. Le fait de travailler dans un but commun nous apportait une fierté personnelle et collective, nous formant graduellement au travail d’équipe et à l’estime de nos frères et sœurs. Tous les autres étés de notre séjour à Sainte-Thérèse nous ont mobilisés à cette tâche et marquèrent notre enfance.
Je me souviens de la dernière cueillette, alors que nous demeurions à Paul-Baie quelques années plus tard, Jean-Marie, Yvon et moi avions pris place dans la boîte du camion de l’un de nos voisins. C’était la dernière journée de cueillette de la saison. Nous étions accompagnés d’autres voisins, intéressés par le même objectif, se faire un petit revenu. Pour l’occasion, on nous fit traverser la rivière Sault-au-Cochon en canot. Une fois les boîtes vides et les passagers traversés, chacun prit une direction différente. Mes frères et moi partîmes vers un endroit où nous serions seuls. Nous étions à peine engagés dans cette direction que, quelle ne fut pas notre surprise de découvrir, j’oserais dire, la talle de notre vie. Elle s’étendait sur un périmètre de quelques centaines de pieds. Il y avait tant de bleuets, que nous ne pouvions pas avancer sans les écraser. Des grappes à perte de vue et de gros fruits. Ce jour-là, à nous trois, nous avons ramassé onze boîtes de bleuets. Le soir, au retour des autres, ils ne voulurent pas croire qu’au cours de cette journée, nous en avions cueilli plus qu’eux tous ensemble. On nous soupçonna même d’avoir garni le fond de nos boîtes de feuilles, de branches, de cailloux, ou je ne sais quoi, pour faire plus vite le plein... Quel beau souvenir!
La purgation générale
Quand arrivait l’automne, venait le temps des inquiétudes de nos parents au sujet de notre santé; la santé, en ce temps-là, prenait une place importante et chaque famille en était responsable selon les savoirs accumulés au cours des années par la culture familiale. Maman avait développé une quantité de réflexes médicaux qui feraient rougir certains de nos médecins d’aujourd’hui! Au début de l’automne, elle sortait sa bouteille d’huile de castor et, en rang d’oignon, elle nous distribuait à l’aide d’une cuillère à table une portion de cette potion désagréable qui dans un délai assez court avait pour conséquence de nous purger jusqu’à la moelle des os. Pendant deux jours, nous subissions les effets dévastateurs de cette médecine. Ma mère était alors heureuse; elle nous avait nettoyé l’intérieur et nous étions prêts à entreprendre une année d’école en santé. Elle avait dans sa trousse de médecin d’autres petits trucs savoureux: un «clou», un furoncle, ne l’effrayait pas du tout. Celui qui souffrait d’une telle irruption devait mastiquer un morceau de pain accompagné d’un peu de beurre. Une fois la mastication terminée, le malade devait recracher cette mixture dans un pansement qui était déposé sur le «clou». Le lendemain, le furoncle s’était par miracle vidé complètement. Les enfants les plus jeunes souffraient souvent d’otites en hiver. Encore là, elle avait un remède de choix. Elle versait quelques gouttes d’urine dans l’oreille du malade. J’étais le fournisseur d’urine! J’étais fier de participer. Aucune otite ne pouvait résister. Je crois que plusieurs préféraient souffrir que de goûter à cette médecine. Il y eut l’huile de foie de morue. Nous ne devons pas oublier la couenne de lard, la mouche de moutarde, les tranches de patates pour la migraine et j’en passe. Ce ne devait pas être si mauvais puisque nous avons tous survécu.
L’école
Avec le mois de septembre 1948, arriva pour moi la rentrée scolaire. Lavés, chaussés en neuf, parfois avec les souliers des plus vieux, habillés de vêtements provenant souvent de la même source, nous empruntions le chemin de l’école. Pour ce qui est des vêtements, ceux que l’on considérait comme neufs étaient ceux cousus par Antoinette. Elle avait l’art de confectionner des vêtements pour tous qui faisaient parfois l’orgueil de nos sœurs. Je peux vous le dire, aujourd’hui, je vous trouvais belles et vous aviez fière allure.
Quelle école! D’une seule pièce, remplie de petits bureaux dont la base de métal supportait le dessus en bois. Ce nouvel univers me rendait assez nerveux. Nos places nous furent désignées et enfin je faisais partie de la gang, j’avais un bureau et un territoire à moi.
Un immense tableau noir masquait le mur derrière une tribune sur laquelle trônait un énorme pupitre, celui de la maîtresse. Un accueil chaleureux, mais sans effusions. Plus de consignes qu’autre chose, le premier jour. Ce qui m’étonna, ce jour-là, ce fut le rassemblement des plus vieux, mes sœurs étaient de ceux-là, dans une partie de l’école, tandis que nous les plus jeunes étions regroupés dans un autre endroit: je me souviens de la déception ressentie, à l’idée d’être séparé de mes sœurs. C’était sans doute la première fois que je me retrouvais seul, loin des miens, hors du milieu familial et j’en ressentais une certaine anxiété. J’appris vite à me passer d’elles, car pour la première fois je pouvais me faire des amis.
L’école était, sans contredit, l’occasion de s’ouvrir sur le reste du monde, de rencontrer des jeunes de notre âge, enfin de développer des amitiés. Notre famille était tellement tissée serrée en une bulle hermétique, qu’il était très rare de communiquer avec les petits voisins, encore moins de jouer avec eux. Je n’ai jamais su pourquoi cet aspect de notre socialisation était systématiquement mis en veilleuse. Nos parents voulaient sans doute protéger les valeurs et l’éducation qu’ils nous avaient données, ou encore éviter d’imposer notre nombreuse présence aux voisins. Ils pouvaient aussi se dire que nous étions assez nombreux pour se faire des amis à la maison. Quoi qu’il en soit, malgré la difficulté d’approcher les voisins, pour ma part, je ne me suis jamais senti perdant de cette décision de nos parents.
L’école nous permettait d’apprendre la lecture, l’écriture, les mathématiques, et surtout, l’histoire sainte et le catéchisme. Les professeurs nous révélaient d’autres mondes jusqu’alors inconnus et nous faisaient rêver. Je me demande encore comment j’ai pu apprendre, dans une école de rang aux multiples niveaux, alors que l’institutrice devait enseigner à six classes à la fois. C’était assez pour distraire quiconque, surtout que j’étais toujours assez distrait. Mon souvenir le meilleur était d’écouter l’enseignement dispensé aux plus vieux. Il y avait aussi les punitions distribuées aux plus turbulents: faire le piquet au coin, ou encore goûter à la règle. Dans notre famille, personne n’osait commettre une infraction digne de punitions; nous savions qu’il y aurait toujours un bavard pour rapporter l’incident à la maison, et risquer une deuxième punition. Nos parents ont toujours été pro fesseurs…
J’ai fréquenté l’école de Sainte-Thérèse jusqu’en quatrième année. Il ne me reste de cette période que de vagues souvenirs. C’est comme si ce temps s’était écoulé dans le brouillard, comme si j’avais rêvé! Je ne sais pourquoi…
Les patates
Quand arrivait le mois d’octobre, c’était de nouveau la mobilisation générale. Nous avions deux champs de pommes de terre à une bonne distance de la maison, derrière la montagne. La terre était belle, sablonneuse à souhait, de couleur quasi orangée n’attendant que les tubercules. Notre père en semait une quantité industrielle et le résultat dépassait toujours les attentes. Donc, à la toute fin de l’été lorsque la température s’annonçait favorable, nous quittions l’école pour quelques jours, afin d’aider à la récolte.

Encore là, c’était le branle-bas de combat: le cheval devait être attelé à la charrette, dans laquelle on avait mis une charrue pour tourner la terre. Rien n’était oublié: pioches, râteaux, chaudières, poches de jute et bien sûr beaucoup d’eau et la nourriture pour la journée. Tous assis frissonnants, derrière notre père, dans l’air vif du matin d’automne, le cheval nous amenait au travail. Cette corvée ne semblait pas plaire outre mesure à quiconque, mais on y allait. C’était, sans que nous en soyons réellement conscients, une opération extrêmement importante, puisqu’à cette époque, la pomme de terre faisait partie de la nourriture de base des Québécois, surtout à la campagne. Une fois arrivés, on attelait le cheval à la charrue et, miraculeusement, dans le sillon, se dévoilait sous nos yeux, le travail silencieux de la terre au cours de l’été: une multitude de patates, de toutes grosseurs. Chacun se mettait aussitôt à la tâche, avec les pioches pour déterrer tout ce qui se cachait encore. L’avant-midi se terminait, sous le soleil éclatant, et la terre se transformait en une mer de pommes de terres blanches, encore un peu luisantes, qui sècheraient en attendant le grand voyage. Après le dîner venait le ramassage. Les plus vieux et notre père empochaient les plus grosses et nous les jeunes, ramassions les petites pour nourrir les cochons. Le soir, la charrette surchargée de poches remplies à pleine capacité s’ébranlait, tirée par un cheval fatigué. Nous suivions exténués l’attelage et revenions lentement vers le caveau extérieur. Ce caveau était placé à une bonne distance de la maison, car il avait dû être construit dans le sable. Un immense trou avait été creusé dans lequel on avait monté des murs, le tout recouvert d’un plancher. À l’intérieur, des murets délimitaient les espaces où l’on pourrait entreposer les légumes durant tout l’hiver. Une trappe s’ouvrait, et une échelle permettait de descendre; on pourrait appeler cela une cave de terre, sans maison dessus. Cependant, Eugène avait construit un abri au dessus de ce caveau afin de le protéger des intempéries. Le plancher était isolé avec de la sciure de bois afin d’empêcher le gel d’atteindre les précieux légumes. Alors, arrivés à destination, on vidait les poches de patates dans une dalle les acheminant à l’endroit où elles devaient hiverner. Cette opération durait deux jours, puis nous retournions à l’école, laissant les patates dormir dans le noir.
Quand j’y pense aujourd’hui, je comprends pourquoi cette culture était si précieuse: il n’existait pas un repas où l’on ne voyait ces légumes servir d’accompagnement et parfois, même, de mets principal: exemple la fricassée et bien d’autres.
Ce caveau était cadenassé de l’extérieur, car à quelques reprises, des voisins, affamés sans doute, étaient venus se servir sans permission, ce qui irritait notre père au plus haut point. C’était la nourriture de ses enfants et il la défendait avec véhémence.
Nous visitions cet endroit aux quinze jours, la responsabilité était surtout confiée à Huguette. C’est elle qui devait, avec l’un d’entre nous, aller chercher les victuailles. Nous entrions par la trappe dans cette caverne sombre et silencieuse, éclairés par un fanal à l’huile jetant des ombres menaçantes sur les murs. Nous ramassions en vitesse l’épicerie des deux semaines à venir, pour ensuite les apporter dans la cave de la maison.
Pauvre Huguette! Un jour de décembre, elle oublia de recouvrir la trappe extérieure du caveau de son isolation contre le froid. Un peu plus tard, Eugène, revenant des chantiers, découvrit toute la production de légumes et de pommes de terre gelée... Découragé, après avoir tant travaillé, et déçu de se retrouver devant un hiver où ses enfants manqueraient du nécessaire, il manifesta haut et fort sa déception et sa colère. Ce n’était pas tant contre Huguette que contre la situation, et pourtant! Nous étions tous affligés devant cette catastrophe, sachant que nous n’avions pas planifié les sommes nécessaires au remplacement de toute cette nourriture.
Marcel, assis au bout de la table, témoin de la catastrophe et n’écoutant que son grand cœur, se leva et tendit deux cents dollars à notre père; c’était sa paye de deux mois de travail dans les chantiers! Il aida ainsi toute la famille à surmonter cette difficulté. Ce jour-là, un autre nuage se dissipa et l’inquiétude, comme bien des fois, fit place à l’espoir.
Par la suite, nous dûmes, à regret, sortir et jeter toute cette récolte.
Et durant plusieurs années, ce cérémonial de la cueillette se répéta; toujours les mêmes gestes et manœuvres, aux mêmes temps de l’année.
La boucherie
L’année était séquencée par des événements significatifs et le mois de novembre marquait le point sur l’un d’eux. Vers la fin du mois de novembre, à l’annonce des froids d’hiver, Eugène décidait de faire boucherie. À ce moment-là, nous surveillions la route pour voir venir M. Bourgouin, à pied. Un grand homme qui avait toute la confiance de notre père pour abattre les porcs et la «taraille», taure, comme il disait. Jamais Eugène, malgré ses airs d’homme insensible, n’aurait levé la main sur ses propres bêtes qu’il avait tant chouchoutées. Encore moins les abattre. Ce M. Bourgoin nous faisait un peu peur, car il venait tuer les animaux que l’on avait bien connus.
Une petite remise attenante à la maison recevait toute cette viande qui, le froid aidant, se conservait pour le reste de l’hiver; on nommait cette pièce, la dépense. On y entreposait toute la nourriture que l’on voulait conserver. Cette boucherie apportait des mets inhabituels, comme le boudin, le cœur, le foie et bien d’autres.
La conservation
La conservation des aliments était une préoccupation constante de nos parents. Il y avait, bien sûr, les pots de conserves préparés lors des récoltes d’été: confitures, betteraves, ketchup et autres. Les viandes et les poissons étaient conservés autrement, en prévision des saisons chaudes. La recette était la saumure. Le lard était empilé dans un baril, rempli de saumure qui préserverait cette viande pendant une longue période, même par temps chauds. Il en était de même pour la morue, le flétan et le hareng, achetés en grande quantité et qui attendaient silencieusement d’être consommés. Antoinette devait faire dessaler le poisson, au moins une journée à l’avance avant de le cuire. Mes papilles se souviennent du trop-plein de sel resté dans ces aliments, malgré le trempage, et qui me faisait grimacer. Je devais être sensible! Ou «avoir le goût dérangé», comme disait notre mère. Cette opération de conservation permettait d’avoir des protéines animales toute l’année.
La Sainte-Catherine
Quant arrivait le 25 novembre, un événement spécial nous rendait très heureux: enfin arrivait la Sainte-Catherine. La fête des vieilles filles comme on la nommait, se transformait, pour nous, en fête de la tire. Les sœurs les plus âgées se mettaient à la cuisine pour faire de la tire. Elles employaient surtout de la mélasse. Elles laissaient chauffer ce liquide sur le poêle jusqu’au moment où des fils se forment au bout d’une cuillère tenue au dessus du chaudron. La cuisson était à point, et on laissait refroidir le tout. Une fois le contenu assez solide et durci, elles commençaient à l’étirer dans tous les sens, ce qui donnait de longues mèches dorées que l’on étirait encore et encore. Nous, les plus jeunes, étions comme des mouches autour d’elles et salivions pendant toute l’opération. Une fois les mèches bien façonnées, il fallait les étendre dehors sur la corde à linge pour les laisser durcir. On les coupait, pour ensuite les envelopper en petites bouchées. Cet exercice durait toute la journée, exerçant notre patience et attisant notre gourmandise. Le soir, toute la famille était conviée à déguster ce délice. Ces papillotes, «kiss» dans notre langage, s’attachaient si solidement à nos dents qu’il était rare de voir l’un d’entre nous en manger à sa faim. Cette tire nous empêchait d’être gloutons. Au cours de cette dégustation, parfois quelques-uns d’entre nous avaient une drôle de surprise! Ils développaient à leur grand désarroi un bout de queue de cochon qu’Eugène avait soigneusement gardé, avec la complicité d’Antoinette, pour nous taquiner.
Les Fêtes
Quelle période de fébrilité pour nous que l’approche des Fêtes! C’était le temps du magasinage à la maison. Les catalogues Sears, Eaton et Dupuis & Frères servaient à toutes les sauces. Pour notre mère, c’était la seule façon de magasiner; pour nous, une occasion de rêver à tous ces trésors inaccessibles, nous en étions bien conscients.
À l’approche des Fêtes, une résignation silencieuse nous envahissait, face à ce temps qui ralentissait quasi volontairement, pour allonger notre attente. Nos corps étaient présents à l’école, mais notre esprit rêvait déjà à la fête.
Enfin, les vacances! La maison sentait meilleur que jamais: les pâtés à la viande, la tourtière du Lac Saint-Jean, les beignes, les tartes, tout contribuait à alimenter notre impatience. Enfin, la veille de Noël arrivait. On n’osait même plus penser à ce qui nous attendait; nous nous abandonnions déjà à la félicité, au bonheur d’un climat de rêve que nous avions tant de fois imaginé. Le tourbillon de notre mère autour des chaudrons, l’excitation des aînées nous repoussant chaque fois que nous devenions trop curieux, nous faisaient nous sentir bien inutiles, mais combien heureux.
La messe de Minuit
Le souper de la veille de Noël était semblable à tous les autres. La prière du soir oubliée dans tout ce brouhaha et pour nous la mise au lit venait abréger l’insupportable attente. Deux années consécutives, je fus choisi parmi les chanceux qui iraient à la messe de minuit. Je fus tiré du sommeil vers dix heures du soir, encore perdu dans mes rêves et ne sachant trop ce qui m’arrivait. Une fois bien réveillés et habillés, avec les cinq ou six frères et sœurs choisis, nous observions Eugène s’affairer dehors autour de la carriole. Quand nous sortions, le cheval blanc nous attendait, attelé au traîneau rouge où nous nous réfugions sous la chaude et confortable peau de carriole, d’où ne dépassaient que des yeux et des nez. Mon père, endimanché, assis droit comme un piquet sur le siège de devant, mettait quelques secondes à démarrer le convoi, comme pour savourer lui aussi le moment. Quelle musique que d’entendre les grelots, la neige foulée par les sabots du cheval, le son des patins de la carriole glissant sur la neige, la nuit, la voûte étoilée et l’air froid nous caressant le visage! Tout était réuni pour nous abandonner au bonheur.
Arrivés au village, quelle n’était pas notre surprise de voir autant de monde et de chevaux! Illuminé, le parvis de l’église grouillait de paroissiens s’engouffrant par la grande porte. La messe était beaucoup trop longue: j’appris plus tard qu’en ces temps-là, il n’y avait pas une messe de minuit, mais trois. Assez pour faire un petit somme. Nous les plus jeunes, bercés par les cantiques de Noël nous nous endormions recroquevillés sur le banc et continuions à dormir tout le long du retour. Et quel retour! Antoinette, pendant notre absence, avait préparé la table de toutes les victuailles cuisinées avec tant d’amour les jours précédents. La faim aidant, nous nous jetions sur ces bons plats aux saveurs si délicieuses, mais déçus très vite par la petitesse de notre estomac; nous avions eu les yeux plus grands que la panse!
Fatigués et heureux, chacun regagnait son lit, engourdi, en rêvant des cadeaux à venir.
Le lendemain, j’étais toujours surpris de voir notre père se lever aussi tard. La seule fois en un an où il dépassait six heures du matin. La maisonnée, pour l’occasion, le rejoignait vers dix heures, encore toute ensommeillée. Eugène, en homme responsable s’empressait d’aller nourrir les animaux qui eux n’avaient pas eu la chance de réveillonner.
Le déjeuner était le prolongement du menu du réveillon qui régalerait encore une fois tout le monde au cours de la journée. Noël était une journée de vacances pour tous, Antoinette y compris. La veille, nous avions accroché nos bas qui n’étaient jamais assez grands au mur du salon. Après le déjeuner, la porte de la caverne d’Ali Baba s’ouvrait de la main de notre père. Tous entassés sur les divans et chaises du salon, nous attendions, les yeux agrandis d’impatience. Eugène distribuait à chacun d’entre nous le bas tant espéré. Celui-ci était rempli, parfois de fruits et de bonbons accompagnés d’un ou deux crayons au plomb neufs, parfois, de crayons de couleurs en cire. Il arrivait qu’un cadeau plus consistant se glisse dans les bas, comme une tablette à écrire, une tuque tricotée en cachette ou une paire de bas. Cette surprise, surtout cette attention qu’avaient eue nos parents à notre égard nous remplissait de joie. Nous savions qu’ils nous avaient donné le maximum, surtout leur amour. Après cette cérémonie, chacun se retirait avec son trésor, rempli de bonheur et de satisfaction d’avoir enfin vécu ce rêve tant attendu. Les uns engloutissaient leurs bonbons, tandis que d’autres les conservaient pour plus tard, ne se doutant pas qu’ils partageraient, incapables de refuser, devant de si grandes supplications.
La semaine séparant Noël et le Jour de l’An était consacrée aux jeux extérieurs, pour nous, les garçons. Notre principale activité consistait à creuser des tunnels dans les bancs de neige accumulés par le vent, le long du hangar. À la fin de la semaine, ces tas de neige ressemblaient à un immense gruyère. Comme tous les enfants, nous aimions nous sentir en sécurité dans ces igloos qui devenaient nos châteaux qui malheureusement disparaîtraient avec le soleil du printemps; mais pas nos souvenirs. La glissade, dans la montagne, en face, était aussi une de nos activités préférées. À la maison, chaque fois que les filles se plaignaient de notre présence, nous étions mis à la porte.
Le Jour de l’An
Les fêtes ne se limitaient pas seulement à Noël. Il y avait aussi, le Jour de l’An. Pour nous, les enfants, ce Jour de l’An était surtout une fête pour les plus vieux, car on y recevait la visite de notre oncle Gustave, frère de ma mère et son épouse, tante Lucienne: eux aussi, étaient devenus colons dans les mêmes circonstances que nos parents à Sainte-Thérèse.
Le Jour de l’An
Les fêtes ne se limitaient pas seulement à Noël. Il y avait aussi, le Jour de l’An. Pour nous, les enfants, ce Jour de l’An était surtout une fête pour les plus vieux, car on y recevait la visite de notre oncle Gustave, frère de ma mère et son épouse, tante Lucienne: eux aussi, étaient devenus colons dans les mêmes circonstances que nos parents à Sainte-Thérèse.
La bénédiction
Une tradition à laquelle nous étions tous conviés était la bénédiction paternelle qui prenait une place primordiale au Jour de l’An. C’était une cérémonie remplie de simplicité, de respect et d’amour qui venait une fois de plus nous faire réaliser que nous formions un noyau de vies tissées serré. Je me souviens avec quel sérieux papa nous adressait quelques paroles de souhaits pour l’année nouvelle pour ensuite tendre la main pour nous bénir tous au nom de Dieu. C’était un moment magique qui nous projetait en nous-mêmes quelques instants savourant la paix intérieure laissée par ce geste de notre père.
Les victuailles
Le repas du Jour de l’An se composait, comme plat principal, du «sea pie» ou «six-pâtes», préparé exclusivement par Eugène pour l’occasion. La veille, il mettait sa viande en cubes, préparait les oignons, les patates, les assaisonnements, la pâte et, le soir venu, il enfournait le tout pour la nuit.
Au matin, c’est avec fierté qu’il sortait le grand chaudron de fonte. Il en levait le couvercle triomphalement, pour découvrir ce qu’il considérait comme un chef-d’œuvre; sentiment que je comprends bien aujourd’hui, quand il m’arrive de faire la cuisine. J’ignore si c’est parce qu’il était interdit de critiquer ce plat de fête, mais je n’ai jamais entendu personne s’en plaindre ouvertement! Trêve de plaisanteries, je me souviens, c’était très bon, et j’en conserve un excellent souvenir, surtout que ce plat ne revenait qu’une seule fois par année. Le Jour de l’An, notre père, notre oncle Gustave et, parfois, Léo Durand, un voisin, passaient l’après-midi à discuter de leurs affaires, en buvant quelques petits verres, qui avaient tôt fait de réchauffer la discussion et l’atmosphère. Ce petit «boire», comme disait notre père, provenait, lui aussi d’un achat par catalogue.
Au cours de cette journée, que nous considérions assez ordinaire, nous retournions à nos jeux habituels. Pour nous, la fête était déjà terminée et les vacances tiraient à leur fin. L’école recommencerait quelques jours plus tard. Mais, nous étions tous remplis du souvenir des merveilleux cadeaux rêvés, même si nous ne les avions pas reçus, et surtout, de cet amour sécurisant que nous avions partagé.
L’hiver
L’hiver, sur la Côte-Nord, n’était pas une mince affaire. D’abord, il faisait froid, très froid. Notre autobus scolaire était continuellement en panne… «C’est une blague»; nous devions parcourir le mille nous séparant de l’école avec nos jambes sur nos pieds gelés. Nous n’étions pas les seuls à subir ce supplice, tous nos voisins y étaient soumis. Une chance, l’école était bien chauffée! Il était impensable que la température nous ait empêchés de faire l’aller-retour. Quand j’y pense, aujourd’hui, cela n’était pas si pire! Les engelures on connaissait ça!
Les tâches domestiques
L’école demandait du courage, mais il y avait plus encore. C’était, pour Eugène, Marcel et Bertrand, la longue saison dans les chantiers, du Jour de l’An jusqu’à Pâques. Alors, il fallait pallier à cette absence: faire le train à l’étable, traire les vaches, veiller à ce que les poules ne manquent de rien, rentrer le bois, enfin remplacer papa. Je me rappelle qu’à ce moment-là, la seule main-d’œuvre disponible étaient Bertrand et ensuite, Huguette, et moi la suivant pour l’aider, mais je ne servais pas à grand-chose, puisque je n’avais que sept ou huit ans. J’ai été témoin du dévouement et du courage de cette sœur, qui a toujours été pour moi un modèle. Matin et soir, elle s’affairait à accomplir les tâches les plus rudes, sans se plaindre, avec le sourire et la grandeur d’âme, que nous lui avons toujours connus. J’avais une GRANDE SŒUR, dans tous les sens du terme. La patience et la bonté de cette fille étaient sans limites. Il y avait aussi Lucette et Colette mettant la main à la pâte, malgré leur jeune âge. Elles s’occupaient de ramasser les œufs, de soigner les poules et, à l’occasion, de rentrer le bois. J’essayais d’aider, mais je nuisais, je crois, plus souvent qu’autrement!
Quelques années plus tard, lorsqu’Huguette dut travailler comme aide-domestique chez des voisins éloignés, je pris la relève. Alors je compris ce qu’avait accompli notre sœur. J’ai trouvé ça terrible au début, ne pas avoir la force physique pour exécuter les tâches et de n’avoir personne, non plus, pour m’aider et m’encourager. La tâche la plus difficile fut assurément de ramasser le fumier et le projeter, à la pelle, sur le tas, par la porte derrière l’étable. Quand celle -ci était bloquée, puisque je ne pouvais pas lancer cet engrais assez loin, je devais, avec une hache, casser cet élément glacé et nauséabond pour pouvoir enfin la dégager. Ça sentait mauvais et après coup, je sentais la même chose. Il ne fallait surtout pas se plaindre ni demander de meilleures conditions de travail.
Absence d’émotions
Je me rends compte aujourd’hui, malgré les efforts fournis, combien les mots de réconfort et de motivation étaient rares pour ne pas dire inexistants. Et nous ne nous attendions pas, comme enfants, à en recevoir. C’était comme ça. Comme au jeu d’échec, nous remplissions une case de l’échiquier pour que, nous l’espérions, la partie se continue et soit gagnée. Combien précieux ont été ces rares moments où nous avons reçu un mot d’encouragement ou de reconnaissance! J’ai des regrets à ce sujet, mais comment pourrais-je blâmer nos parents qui n’en recevaient pas plus que nous et qui, jour après jour, assumaient une responsabilité de géants? Nous n’avions pas le temps de nous attendrir. En ces temps-là, la sensibilité devenait de la sensiblerie, donc, sans importance. Chacun devait être fort et garder pour lui ses états d’âme. Même pleurer était déplacé. Il ne fallait pas montrer ses émotions. C’était dangereux, si nous y avions été autorisés, nous aurions ouvert un barrage de larmes, et nos parents auraient sans doute été les premiers à s’y engouffrer. Valait mieux se taire et faire semblant. Nous avons alors remplacé les sentiments par les sensations.
Pour plusieurs, cette époque nous a profondément marqués. La vie a dû nous rééduquer et nous apprendre que l’amour, la tristesse, l’affection et l’appréciation de l’autre se traduisent en mots et gestes, et que s’exprimer était aussi important que de respirer. Autant pour celui qui le fait que pour celui qui le reçoit. En ces temps-là, nous avions appris que la seule façon de communiquer était de blâmer et critiquer. Il est temps de changer et découvrir combien il est doux de dire que l’on s’aime et de s’apprécier. Éprouver de tels sentiments peut guérir tant de blessures accumulées. L’amour révélé libère, autant celui qui aime que celui qui est aimé.
Les chemins d’hiver
Le chemin du rang prenait les allures du reste du paysage lorsqu’arrivaient les premières neiges. En effet, la neige s’accumulait au rythme des tempêtes et se foulait sous les sabots de chevaux. Il n’y avait pas beaucoup de circulation et pour cause. Un ou deux cultivateurs par semaine pouvaient passer devant la maison paternelle. S’il neigeait, les seules traces étaient celles de nos pas jusqu’à l’école.
Au cours de notre séjour à Sainte-Thérèse, la technologie aidant, une machine fit son apparition, elle sillonnait régulièrement notre chemin.
On l’appelait le «snow mobile». Cette machine ressemblait étrangement à un sous-marin avec sa rangée de hublots de chaque côté. Au-devant, deux petites fenêtres permettaient au chauffeur de voir la route. Une seule porte en permettait l’entrée. Ce véhicule étrange, équipé de deux chenilles lui permettant de flotter sur la neige, était précédé de deux skis mobiles, rendant possibles les détours. Une fois par semaine, cette machine faisait le taxi pour ceux qui désiraient assister à la messe du dimanche. L’espace y était restreint et je me rappelle avoir utilisé ce véhicule avec nos voisins, entassés comme des sardines dans l’abri silencieux où flottait une odeur d’humidité humaine et attendre la délivrance de l’arrivée à l’église. C’était la chaleur humaine!
La naissance des derniers enfants
Antoinette était enceinte tellement souvent que nous étions, à la fin, suspicieux quand elle n’avait pas un ventre proéminent. Personne ne nous expliquait d’où venaient les bébés et encore moins comment on les faisait. Ils arrivaient et c’était ainsi. Cependant, à quelques reprises, nous avons été mis hors du circuit lors de la naissance d’enfants, je me rappelle qu’à celle de Lise et de Denise, les jumelles, nous avons été envoyés chez le voisin, M. Charron, pour un certain nombre d’heures. Mme Charron était la sage-femme de la place et s’était rendue à la maison pour accueillir nos deux petites sœurs. Je crois que cette dame a vu une bonne quantité d’entre nous venir au monde et pleurer pour la première fois. À la naissance des jumelles, je me suis rendu compte à quel point il y avait de la joie dans la maison, et combien les filles aînées étaient heureuses de les tenir dans leurs bras. Quant à Michel, il arriva sans déranger personne par une belle nuit de janvier, pendant notre sommeil. Au matin, en l’entendant pleurer, nous savions qu’il y avait un nouvel arrivant.
Le trajet des enfants après leur naissance était bien planifié, au cours des premiers mois, les bébés dormaient dans une petite couchette placée dans la chambre de nos parents. Par la suite, ils se retrouvaient dans des lits plus grands, installés dans la chambre des filles aînées. Plus tard, ils graduaient dans leur chambre définitive. Jusqu’à l’âge de dix ans, j’ai vu circuler les bébés ainsi dans la maison.
Le printemps et Pâques
L’approche du printemps correspondait toujours au Carême, période de pénitence par excellence. Pour l’occasion, Antoinette sortait ses litanies qu’elle ajoutait aux prières de soir. Le jeûne était une obligation pour les adultes. On allait jusqu’à peser la nourriture afin de respecter les règles émises par l’Église. Pendant ce temps, toute notre vie devait être souffrance; en plus de celles que nous rencontrions chaque jour, nous devions nous en imposer de supplémentaires. Nous allions, lors de la prière du soir, jusqu’à nous agenouiller sur des bûches de bois aux arêtes coupantes pour montrer qu’on s’associait au courant de souffrance qui avait envahi la maison. Ces renoncements étaient tellement valorisés, que c’était l’escalade à savoir qui souffrirait le plus. Eugène et les plus vieux arrêtaient de fumer pour la période et combien se mortifiaient en plus de jeûner.
La Mi-Carême
Après quatre semaines de ce régime, arrivait la Mi-Carême. Cette étape nous permettait de comprendre que la moitié du chemin était fait et que tout rentrerait bientôt dans l’ordre. La Mi-Carême, c’était l’expression par les jeunes adultes du voisinage que la joie et la fête n’étaient pas disparues pour toujours et que tout ce qu’il y avait, avant cette période de mortification, existait encore. Pour l’occasion, chacun se déguisait et parcourait la campagne pour s’introduire dans les familles qui les recevaient avec une joie non équivoque, alors que toute la maisonnée tentait en vain de découvrir qui se cachait derrière ces déguisements. Ils se présentaient en vagues de trois ou quatre individus, en faisant le plus de bruit possible avec leurs voix pour nous faire peur. Cette seule coutume mineure donnait un souffle nouveau à notre famille esseulée et nous remplissait de souvenirs nous habitant encore, après tant d’années.
Nous n’avions pas participé à ces événements avec les autres, mais nous avions tous hâte de les revoir à chaque année.
Pâques
Enfin, le temps de Pâques arrivait! La Semaine sainte faisait monter notre ferveur à son paroxysme. Plus nous nous rapprochions de la mort de Jésus, plus nous devions adopter un état de peine et de révolte intérieures pour ce qu’on lui avait fait. Cette escalade atteignait son point culminant le Vendredi saint après-midi, alors qu’Antoinette allumait la radio qui faisait revivre le chemin de la croix à toute la province de Québec. Pour l’occasion, elle sortait un grand cahier contenant des images géantes des diverses stations du chemin de la croix. À chaque station commentée, nous tournions les pages de cet album, et, quand notre indignation devenait trop grande, il arrivait que l’un d’entre nous égratigne de ses ongles, soit un soldat ou un mécréant qui faisait souffrir Jésus. Antoinette nous le permettait, mais pas trop fort, il fallait garder de la place pour les égratignures de l’année suivante.
Le soir du Vendredi saint arrivaient les bûcherons soit Marcel, Bertrand et surtout notre père. C’était pour nous la fin de l’hiver! Eugène resterait jusqu’à l’été et la période de mortifications finirait le lendemain à midi. Aussi, la maison était toute différente et les nouveaux venus venaient remplir le vide ressenti depuis leur départ. Antoinette se mettait à la cuisine et préparait le repas du samedi midi, marquant ostensiblement la fin des privations. Quand midi sonnait, un sentiment de liberté et de joie remplissait la maison. Eugène et les plus vieux distribuaient les surprises achetées pour l’occasion, surtout des bonbons et du chocolat, tandis qu’eux-mêmes sortaient la première cigarette accompagnée de la première bière, depuis quarante jours. Le repas était succulent et surtout le dessert. Pour nous, les enfants, tous ces moments revêtaient cette importance et ce merveilleux qui nous rendaient heureux, même si c’était des petits riens.
Le printemps
La neige commençait à fondre et les champs se gorgeaient d’eau. De grandes étendues de glace se formaient la nuit et se liquéfiaient le jour, se transformant ainsi en autant de lacs remplis de dangers. C’était aussi le temps de la «croûte», nous supportant sur la neige et nous permettant de glisser où nous voulions. Les plus vieux continuaient la saison du printemps à la drave, tandis que notre père préparait déjà la place pour le temps des semailles. Les quelques vaches mettaient au monde de petits veaux et on sortait de plus en plus les bestiaux dehors au soleil du printemps, et la vie recommençait graduellement.
Avec la venue des températures plus chaudes, Antoinette vidait la dépense de toute la viande qui restait et la mettait en conserve dans de grands pots de verre. Les couches chaudes s’organisaient du côté sud de la maison, tout sentait la vie nouvelle. Sans que nous nous en rendions compte, l’été revenait avec le miracle de la vie; inconsciemment, nous étions heureux de faire encore partie de cette vie.
Eugène devenait de plus en plus actif dans sa préparation de la saison d’été. Il se mettait au travail avec le soleil et sa journée se terminait sur un appel d’Antoinette lui criant:
«Eugène, Séraphin commence»!
Cette émission de radio à 7 h 30 du soir, marquait la fin du labeur. Et c’est ainsi que recommençait un autre été plein d’aventures et de découvertes.
Au mois de mai après le dur hiver,
Je sortirai, bras nus dans la lumière
Et lui dirai le salut de la terre…
Les bourgeons sortent de la mort,
Papillons ont des manteaux d’or,
Près du ruisseau sont alignées les fées
Et les crapauds chantent la liberté
Félix Leclerc
Le cheptel
Pour notre père, les animaux faisaient essentiellement partie de la subsistance et de la survie de tous. Il en prenait soin, autant que d’une fortune. Les vaches représentaient la vie des enfants; leur lait les nourrissait adéquatement et, de plus, fournissait à toute la famille la crème, le beurre et tous les autres éléments nécessaires à la cuisine. Quel désespoir pour lui, lors d’un hiver lointain dans ma mémoire, la nouvelle étable n’était pas encore construite quand il assistât à la mort des deux seules vaches qui formaient son troupeau. Toutes deux étaient enceintes, c’était quatre bêtes qui partaient du coup. Il n’y avait pas de vétérinaire. Les cultivateurs avaient bien leurs remèdes maison, mais souvent inefficaces. Je me revois ce jour-là, où, posté à la fenêtre givrée, je vis le cheval guidé par Eugène, tirer dans la neige les vaches mortes pour les séparer du reste des autres animaux afin de les protéger d’une contagion possible. Je me souviens à quel point il était triste, marqué par cette mort, et aussi combien ces animaux étaient devenus complices et proches de lui. On peut dire qu’il les considérait comme des partenaires lui permettant de réaliser ses rêves.
Le cheval représentait aussi un allié primordial dans la réussite de ses plans. Le premier cheval de trait, Pit, un cheval brun roux, avec un cœur aussi grand que celui de son propriétaire, faisait équipe pour mener à bien le grand projet soit l’essouchage, le transport du bois, les labours, etc. Il était de toutes les tâches, c’était l’ami de notre père au travail et son complice. Nous nous souvenons tous aussi du petit cheval blanc qu’il affectionnait particulièrement. Ce cheval servait exclusivement aux déplacements de la ferme au village ou ailleurs. Il en était particulièrement fier, car il était le seul des alentours à posséder un cheval destiné exclusivement à tirer le «buggy», l’été, ou le «barlo», l’hiver, surtout que ce cheval avait belle allure. Il me revient en mémoire des scènes du téléroman Les Filles de Caleb, où l’un des personnages était si fier de ses chevaux. Eugène n’en tirait pas d’orgueil, mais certainement une grande fierté. Plusieurs chevaux passèrent à la ferme familiale. Le dernier dont je me souviens était un cheval noir, d’une douceur et d’un dévouement incomparables. Cependant, après son achat, nous nous aperçûmes qu’il n’était pas capable de se relever une fois couché. Quand il s’étendait dans les champs, nous étions délégués, cinq ou six d’entre nous pour l’aider à se lever. Il se donnait des élans, mais ne pouvait plier les pattes avant et il retombait sur le côté. Après lui avoir passé une corde autour du cou, tout le monde attendait qu’il se donne un élan et alors, ensemble nous tirions de toutes nos forces pour qu’il réussisse à se mettre debout. Quelle fierté pour nous de revenir à la maison avec le cheval sur ses pattes!
Papa perd un ami
La maladie de ce cheval empira et Eugène dut s’en débarrasser, l’abattre, car il n’y avait pas d’autre solution. Je le vois encore partir avec son ami, le fusil à la main, vers la montagne. La tristesse se lisait dans l’allure autant de mon père que dans celle du cheval qui acceptait avec soumission la décision de son vieil ami. Aux aguets, nous n’entendîmes qu’un seul coup de feu, nous atteignant tous autant que le cheval. Beaucoup plus tard, Eugène réapparut à l’orée du bois et, sans doute pour ne pas réveiller la peine, personne n’en parla plus jamais.
Les porcs avaient aussi le respect de notre père, jamais il n’aurait osé tuer par lui-même un de ces animaux. Il faisait plutôt appel à M. Bourgoin. Même tuer une poule lui demandait du courage. Un autre souvenir me rappelle qu’un été, un hibou venait sans se gêner voler les poules ou les poulets de la basse-cour. Eugène saisit son vieux fusil seize, réparé avec du fil de laiton, le chargeât et entrouvrât la porte pour viser le chenapan situé à quelques pas de la maison. Bang, puis plus rien, le silence. Antoinette, après un instant demande à Eugène immobile dans l’embrasure: «Puis, l’as-tu eu ?» Il répondit: «Je ne voulais pas le tuer, je lui ai fait assez peur qu’il ne reviendra plus jamais.» Il avait raison, on ne revit plus jamais ce voleur d’oiseaux. Ceci est une anecdote qui démontre à quel point la relation de notre père avec les animaux était respectueuse. Que de souvenirs au sujet de ces animaux faisant partie de notre vie quotidienne. Je ne parlerai pas des multiples chats, ils étaient naturellement nos compagnons.
Des rêves qui se réalisent
Ceux qui ont connu notre père savent qu’il était essentiellement un homme de projets. Toute sa vie a été consacrée à réaliser projet après projet, au prix souvent de sa santé ou de sa liberté. Au fil des ans, il avait réussi à amasser assez de capital pour aller plus loin et réaliser d’autres ambitions. La voirie locale manifestait le besoin, ces années-là, de personnes capables de prendre des contrats pour ouvrir ou réparer des chemins. Il vit là une opportunité d’améliorer notre sort. Il fallait de la machinerie pour réaliser ce projet. Avec l’aide de Marcel, il trouva un tracteur à chenilles qu’ils achetèrent, et un vieux camion «dompeur», qu’ils acquirent aussi.
C’était la folie à la maison quand ils partirent chercher ces nouvelles machines. Toute la famille s’est tenue à la fenêtre des heures durant, dans l’espoir de voir déboucher au bout du chemin, de l’autre côté de chez Adélard Ouellet, un engin plus gros et surprenant que tous ceux que nous n’avions encore jamais vus. Enfin, arriva l’objet de nos espoirs, un petit tracteur jaune à chenilles de métal qui menait un vacarme indescriptible et crachait une belle fumée noire faisant notre fierté. Nous étions fiers de dire à nos amis curieux que c’était un CATERPILAR D-4, s’il vous plaît. Cette acquisition ressemblait étrangement à un âne, nous nous sommes vite rendu compte qu’il était tâtillonneux et n’était pas toujours disposé à partir. Il était muni de deux moteurs, l’un, plus petit que l’on partait à la main à l’aide d’une corde enroulée autour d’une poulie. Ce petit moteur avait un sale caractère, et certains jours, était aussi têtu qu’une mule. Marcel s’évertuait des heures durant à tirer sur cette corde s’arrêtant de temps en temps pour vérifier soit la bougie ou encore quelques autres éléments importants. Une fois ce petit moteur décidé à coopérer, on le branchait sur le plus gros, qui en crachant un panache digne d’une locomotive se mettait en branle, dans un tintamarre assourdissant. Alors, dans un bruit de métal nous laissant croire qu’il était en train de perdre toutes ses pièces, ce monstre se mettait en marche avec la lenteur d’une tortue.
Malgré sa tête dure, le tracteur répondit aux attentes et permit au père et au fils de réaliser une partie de leurs projets. On dénuda la carrière de gravier derrière le caveau et l’on construisit, avec des troncs d’arbres, un genre de couloir sur lequel le tracteur poussait le sable et les roches dans la boîte des camions. Ainsi, toute l’infrastructure se mettait au point pour le travail à venir. Nous sentions une certaine fébrilité dans l’air, une étape nouvelle s’annonçait. On ressentait une confiance et une motivation encore jamais démontrées par notre père.
Marcel tombe malade
Au cours de l’été 1951, Marcel contracte une maladie grave qui le cloue au lit et l’empêche de continuer son travail. Cette maladie s’était attaquée à ses poumons et nous rendait très inquiets. La garde-malade venait très souvent veiller sur lui et le soigner, mais il n’y avait rien à faire. On dut l’envoyer récupérer dans un sanatorium d’où il revint, guéri, quelques mois plus tard. Avec son retour l’inquiétude disparut.
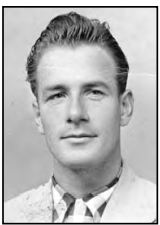
En parlant de Marcel, je voudrais mentionner combien cet homme, sans qu’on le sache, avait une curiosité au-dessus de la moyenne des gens de ce temps. Du plus loin que je me souvienne, il a amené dans notre petit monde de nouvelles idées, de nouveaux concepts, c’est lui qui a acheté la première voiture du rang. Il a, sans qu’on le sache, appris l’anglais en autodidacte. Des caisses de livres anglais remplissaient le deuxième étage du hangar. Il était toujours rempli de questionnements intelligents, parfois accusateurs, envers son entourage. Mais nous lui avons pardonné depuis longtemps. Un dernier fleuron s’ajoute à ses victoires, c’est qu’à un âge déjà avancé, il retourne aux études et réussit son secondaire V. Son implication au conseil municipal et sa contribution comme bénévole nous font voir en lui un homme de bien. Nous reconnaissons un peu notre père en lui avec ses idées, parfois préconçues, mais un jugement solide, basé sur une expérience large et une sensibilité trop grande pour ne pas la cacher sous des artifices intellectuels. Je tenais à dire ceci, parce que parfois la vie nous détourne de la vérité, même concernant nos propres frères et sœurs, et nous devons un jour ou l’autre, en revenir et passer par-dessus nos préjugés. La réalité de la vie est beaucoup plus humaine que nous pouvons l’imaginer. Marcel, tu as été un excellent grand frère.
Un grand silencieux
À la suite de Marcel, venait Bertrand dont la personnalité faisait contraste avec celle de son frère aîné. Lui aussi a contribué grandement à la vie familiale. Jeanine me racontait que c’était lui, au cours des premières années, qui approvisionnait la maison et l’étable en eau. Du ruisseau voisin, à l’aide d’un réservoir attaché sur un traîneau, tiré par le chien, il alimentait, peu importe la température, les besoins de tous, humains et animaux. Son apport aux travaux de défrichement et sa contribution à toutes les corvées ont fait de lui un des bâtisseurs de notre petit royaume. Doué d’une générosité peu commune, d’une intelligence basée sur l’expérience, il se lançait souvent dans des projets ambitieux, qu’il réussissait dans la majorité des cas. Au fil des ans, il est devenu notre confident, nous influençant souvent à voir le bien en chacun des êtres qui nous entouraient, plutôt que de les critiquer. Il fut, à sa façon, un leader; dans son travail, on lui déléguait des tâches de supervision ou encore de responsabilité, dont il était fier, avec raison, et qu’il nous relatait dans les moindres détails, s’il vous plaît! Il avait l’art de détendre l’atmosphère quand les situations devenaient ambiguës. On peut dire que c’était un tendre, un rêveur doué d’une écoute exceptionnelle. Comme les Fillion et les Langlois avaient des caractéristiques différentes, on pourrait dire que c’était plus un Langlois.
Lui aussi a été, sans le savoir, pour nous, un modèle masculin très apprécié après la mort de notre père. Toi aussi, Bertrand, tu as été un excellent grand frère.
Une grande dame
Une princesse est issue de Sainte-Thérèse de Colombier, en notre sœur Jeanine. Elle a toujours eu ce petit air désinvolte, mais combien attachant des grandes personnes! C’est peut-être parce qu’elle nous a tous connus intimement que nous avons eu une influence positive sur elle. Elle est la seule à connaître nos parties intimes pour nous avoir changé de couche si souvent! Elle fut, pour son temps, elle aussi une visionnaire; elle a osé quitter la maison et aller explorer plus loin. Très jeune, elle partit à Hauterive, où elle entreprit de suivre, à l’hôpital récemment construit, une formation comme infirmière. Chaque fois qu’elle revenait, nous étions submergés par ses attentions chaleureuses et sa gentillesse. Elle représentait pour nous, sans le savoir, la lumière, l’esprit d’aventure ainsi que la générosité pure. Nos parents ne tarissaient pas d’éloges à son sujet, malheureusement en son absence. Je crois qu’ils lui vouaient une admiration si grande qu’ils n’osaient lui avouer. Malgré les épreuves rencontrées, elle n’a pas perdu cette chaleur, ce cœur intense que nous lui avons toujours connu. Nous retrouvons en elle, comme chez toutes nos sœurs, maman, avec son sourire perpétuel, son cœur immense, son accueil et sa compassion envers tous, dans le besoin autant que l’adversité. Il y a de ces personnes qui, sans le savoir, projettent une lumière si invitante qu’il nous est impossible d’y résister. Je crois que Jeanine est une de celles-là.
Jeanine se fâche
Je ne peux m’empêcher de raconter ici, une anecdote qui a mobilisé toute la famille, un dimanche après-midi. Jeanine avait trimé dur toute la matinée pour nettoyer la maison et aider maman. Épuisée, elle se battait, contre ses frères qui, sans égards, entraient et sortaient sans délicatesse en salissant le plancher qu’elle venait de laver. Découragée et peut-être en pleurant, elle se réfugia au deuxième étage du hangar, où elle espérait trouver un peu de solitude et calmer sa colère et sa peine.
À un moment donné, au passage de Bertrand, elle imita un chat et se mit à miauler par intermittence. Les sons qu’elle produisait se répercutaient à un endroit opposé, et notre frère se mit à la recherche du chat, loin de Jeanine qui à travers les fentes des planches se mit à s’amuser aux dépens de celui-ci. Dans sa tête, elle se disait: «vous n’avez pas eu de considération pour mon travail, je vais vous faire courir». Comme les miaulements devenaient de plus en plus plaintifs, Bertrand demanda de l’aide pour retrouver ce chat qui avait sans doute bien besoin d’être secouru. Alors, une armée se mobilisa et ce fut la recherche ininterrompue de tous, au grand bonheur de Jeanine, qui prenait toutes les intonations d’une chatte en difficulté, ce qui activait la recherche. Ce stratagème dura une bonne partie de l’après-midi. Ayant pitié de ses frères et sœurs, celle-ci descendit de sa cachette en riant aux larmes, tout en exprimant sa colère face au manque de respect pour son travail. Cette histoire reste encore bien fraîche dans la mémoire de notre famille.
Des rêves et des inquiétudes
Un des grands rêves qu’Eugène avait à cœur était celui d’ouvrir un chemin d’environ 4 ou 5 kilomètres séparant le bout du rang de la route 138, ce qui épargnerait un détour d’environ 12 kilomètres pour rejoindre le même point. Le contrat lui fut donné et les deux étés suivants furent consacrés à ce projet. Comme il était de plus en plus sollicité par ces nouvelles responsabilités, il décida d’engager un employé pour veiller à ce que les travaux de la ferme se fassent. Le nom de cet homme était Gérard Tremblay. Chaque nouveau visage se présentant à la maison piquait notre curiosité au plus haut point. Comme Gérard avait du bagout, il n’a pas manqué de nous impressionner. C’était un bon garçon et, avec le temps, il devint un peu notre grand frère, même s’il aurait préféré devenir notre beau-frère. Jeanine le rendait un peu fou, mais la belle gardait toute sa tête. Gérard, contrairement à nous, prit racine dans ce coin de pays et y demeure encore. Il s’est marié à la fille du voisin, Ernestine Ouellet, et cultive encore, m’a-t-on dit, après toutes ces années, ses quelques arpents de terre. Il est revenu nous visiter bien des années plus tard. Quand j’ai su qu’il était là, j’accourus, comme pour rencontrer un ami de longue date, mais je n’ai pas reconnu ce jeune homme plein de vie de jadis qui nous prenait dans ses bras. Il avait vieilli et moi aussi, ainsi que la relation qui nous unissait. J’ai dû, avec un réel regret, me rendre à l’évidence, les amitiés meurent aussi d’inanition avec le temps.
Quelques années passèrent à ce rythme, nous grandissions et devenions de plus en plus individualisés dans notre personnalité et notre caractère. Nous voyions déjà poindre les futurs adultes que nous serions. Nous partagions de plus en plus de responsabilités et, par le fait même, avions moins de temps pour les jeux. Nous l’acceptions, c’était la règle.
Des signes inquiétants
En janvier 1952, alors que papa avait réussi pour la première fois à décrocher un contrat de coupe de bois à Pointe à Bois Vert, à environ une quarantaine de kilomètres de la maison, et qu’il était à faire les préparatifs de ce projet, une fatigue immense l’envahit et une toux inlassable ne cessait de le harceler. Il eut beau vouloir continuer le travail amorcé, son corps ne le suivait plus. Cet homme qui n’avait jamais été malade et dont la vie avait, du matin au soir, été consacrée au labeur devait s’avouer, pour la première fois, incapable d’aller plus loin, temporairement, espérait-il. Après consultation à Forestville, village situé à environ quinze kilomètres, il fut décidé qu’il devrait se rendre à Québec pour une investigation plus poussée. Pour lui, il n’y avait pas raison de s’inquiéter outre mesure, il réagissait comme tous les hommes qui n’ont jamais été malades. C’est avec Bertrand qu’il fit le voyage. Celui-ci avait amassé assez d’argent pour pouvoir assumer les dépenses occasionnées par ce périple nécessaire, mais non bienvenu, vu les questionnements provoqués. Avant son départ, Eugène dut rassurer Antoinette remplie d’inquiétude. Il lui promit de revenir en santé, ce qui la rassura un peu. Nous ne fûmes pas trop informés du déroulement des consultations à Québec. Bertrand voulait sans doute garder pour lui le drame qui se déroulait, on avait informé Eugène qu’il était atteint d’une tumeur cancéreuse à un poumon, que le mal s’étendrait à l’autre dans un temps indéterminé et entraînerait la mort s’il ne faisait pas opérer le poumon affecté, ce qu’il refusa.
Personne, sauf Bertrand, ne fut témoin du déchirement de cet homme à l’annonce de cette nouvelle. J’imagine le choc, la tourmente intérieure, la révolte, le doute. Comme il a dû crier, jurer, tempêter contre toute cette avalanche de malheur s’abattant sur lui et sur les siens. Lui qui tenait sur ses épaules depuis tant d’années la destinée d’êtres aimés, devenait soudain inutile et de plus, un boulet. Il voyait s’écrouler, impuissant, tout ce qu’il avait construit avec tant d’abnégation et de courage.
Alors, il se mit en travers du plan que la Vie lui imposait et, à son habitude, se cabra contre cette injustice. Il avait toujours réussi à vaincre l’adversité, encore une fois, il sortirait gagnant de cette épreuve. Croyant dans toutes les fibres de son être, il ne céderait pas d’un pouce. Pour lui, la spiritualité ça marchait dans les deux sens: «j’ai consacré ma vie à Dieu, pour une fois, il va faire quelque chose pour moi ». Il sortit, comme le dit Marcel, l’artillerie lourde et appela Marie-Louise, sa sœur religieuse, à Québec, ainsi que le frère de maman, le Chanoine Langlois, et enrôla tous ceux qui voulurent prier pour sa guérison, les enjoignant de ne pas lâcher, persuadé de guérir de cette maladie.
Un triste retour
Nous n’étions pas là, à son retour à la maison, mais nous avons senti que quelque chose avait changé. Antoinette était moins souriante et Eugène paraissait plus songeur que d’habitude. Au cours de l’hiver suivant, notre père n’alla pas dans les chantiers, mais réussissait quand même à accomplir les tâches de la ferme. Antoinette, avec l’accord d’Eugène sans doute, nous informa de la gravité de sa maladie, en nous disant, pour ne pas nous affoler, que ses bons soins et la prière de tous le guériraient assurément.
Cette année-là, il n’y eut pas de cadeaux à Noël. Pas de carriole, de Messe de Minuit, ni de festivités dont je me souvienne. Ce fut un Noël en famille dans la chaleur et l’amour de nos parents, frères et sœurs. Je me représente ces instants comme une douce neige d’hiver: le silence, la blancheur dénudée de sentiments tapageurs, un moment hors du temps. Ce temps, encore aujourd’hui, me rappelle la richesse inestimable ressentie en ces moments de tristesse. Tous autour de la table, nous vivions, sans le savoir, la révolution silencieuse de l’histoire de la famille Fillion.
La bénédiction paternelle prit cette année-là une dignité et une solennité toute particulière. Eugène nous démontra une touchante attention; son regard sur nous s’avérant d’une tendresse et d’une affection jamais encore ressenties.
Les jours se succédèrent cet hiver-là, comme dans un rêve. Tout nous semblait hors du temps, presque irréel. Il n’y avait plus ces rires, ces boutades et taquineries que nous avions toujours connus. Huguette et les sœurs les plus vieilles calmaient les emportements des plus jeunes, laissant planer dans la maison une atmosphère de tranquillité indescriptible. On aurait dit que nous étions à l’écoute et dans l’attente de je ne sais quoi. Nous devinions, dans l’attitude de maman, qu’elle savait déjà ce qui allait arriver.
Le reste de l’hiver se termina ainsi, au ralenti, laissant le soleil fondre la neige et la remplacer par le miracle toujours attendu de la vie printanière. Au fil du temps, imperceptiblement, nous étions témoins de l’évolution de la maladie de notre père, ses quintes de toux s’allongeaient de plus en plus et il requérait plus d’aide aux travaux quotidiens sur la ferme. Il lui arrivait, ce n’était pas son habitude, de tomber dans une réflexion profonde, sans doute à la recherche de tous ces moments de vie vécus heureux et si riches d’espoir et de réalisations.
L’été suivant nous sembla vide, en comparaison des précédents; il n’y avait plus ce même va-et-vient, ce même enthousiasme et empressement à faire l’essentiel. Le jardin s’était amenuisé de moitié, au moins, la fraisière laissait encore émerger quelques fruits timides à travers les mauvaises herbes. Personne n’avait acheté de jeunes poulets, comme par le passé. Le troupeau de vaches et de veaux avait été mis dans le pacage, sans que l’on ait auparavant vérifié les clôtures; quelques-unes avaient réussi à s’échapper. Tout nous semblait différent, il manquait quelqu’un et nous savions qui. Gérard Tremblay était toujours là, mais lui aussi manquait de cette flamme que nous lui avions connue. Nous réussissions encore à vivre notre vie d’enfants, mais sur la pointe des pieds, à pas feutrés, comme si nous ne voulions pas déranger le temps inexorable qui s’écoulait. La saison des bleuets fut de courte durée, n’ayant plus de père pour guider nos pas. L’automne, avec ses activités, passa sans que l’on y prête attention, pour nous amener à ce que nous redoutions en silence, une rechute d’Eugène vers la fin de novembre. La neige était tombée en abondance et malgré le silence extérieur dans la maison, la toux et les gémissements de notre père nous rendaient tristes et inquiets. Plus il souffrait, plus nous étions silencieux. C’est comme si, par respect, nous laissions toute la place à sa souffrance; c’était pour nous la seule façon de l’aider. Au bout de deux ou trois jours, ce que je vais révéler ici n’est pas exagéré, Bertrand attela le chien, mit Eugène sur le traîneau et l’amena chez la garde-malade au village. Le verdict de celle-ci ne se fit pas attendre, il fallait le transporter à l’hôpital au plus vite.
Encore une fois, maman devait vivre l’inquiétude de la séparation d’un être aimé, ne sachant s’il allait revenir. Massés autour d’elle, nous étions à l’affût des moindres marques de réconfort et d’apaisement, alors que c’est elle qui en avait le plus besoin. Nous devenions conscients qu’avec la maladie de papa, la toux, les gémissements, une partie profonde de notre être était partie avec lui pour l’hôpital. La maison s’était vidée de l’un des deux cœurs qui la faisaient vivre et, sans nous en rendre compte, nous ne savions pas comment combler ce vide immense, cette fatalité inévitable.
Toutes les belles traditions de préparation des Fêtes, les commandes par catalogue, cette attente impatiente des rencontres fraternelles autour de l’arbre s’étaient estompées, comme si le temps s’était arrêté. Le père ne serait pas là pour Noël et le Jour de l’An. La tristesse de maman, ses silences, son chagrin, qu’elle avait peine à dissimuler nous enlevaient le goût de la fête. L’hiver se mêlait à cette tristesse, masquant les vitres de givre, laissant la maison dans la pénombre.
Ah! Comme la neige a neigé!
Ma vitre est un jardin de givre
Ah! Comme la neige a neigé!
Qu’est-ce que le spasme de vivre
À la douleur que j’ai que j’ai
Émile Nelligan
Janvier ramena une lueur d’espoir, Bertrand annonçait son retour et celui de papa, sans donner plus de détails. Dans notre petite conscience, il était guéri, c’en était fini de nos inquiétudes interminables.
Le 11 janvier, le snow mobile s’arrêta devant la porte. Attroupés aux fenêtres, nous vîmes Bertrand sortir du véhicule, portant notre père dans ses bras. Nous étions tous consternés; le pilier, la force, l’être le plus fort que nous ayons connu, était tombé, tel un arbre, et nous ne pouvions pas imaginer encore que c’était possible. Nous ne pouvions que nier cette évidence et raviver notre espoir.
Les jours suivants furent sans contredit, pour nous, un retour brutal à la réalité, l’état de notre père s’était tellement détérioré pendant cette absence, il ne quittait que rarement le lit. Il n’était plus le même, tout ce qu’il lui restait de force, il l’employait à lutter pour s’agripper au peu de vie qui le quittait peu à peu. Les rares moments où la maladie lâchait prise pour aller chercher une énergie nouvelle, afin de revenir plus forte et virulente, il en profitait pour nous regarder avec tendresse et nous dire, en silence, tout son amour et ses regrets de nous faire souffrir. Il s’accrochait avec tout le courage que nous lui connaissions à un filet de vie qui s’amenuisait irrémédiablement. Vers la mi-février, on demanda à Jeanine de laisser l’hôpital et venir assister papa qui allait de plus en plus mal. C’était la seule qui pouvait le faire, selon l’avis de tous. Excepté le train, les activités coutumières et tout le quotidien habituel, la vie s’était arrêtée. La besogne se faisait machinalement, l’esprit était ailleurs. Le dimanche après-midi suivant son retour, les voisins, Léo Durand, François Charron, Adélard Ouellet, Raymond Savard et quelques autres se présentèrent à la maison pour faire, paraît-il, une visite de courtoisie à notre père. Jamais on ne lui aurait avoué le but de cette visite, on venait lui dire adieu. Assis dans son lit, détendu pour l’occasion, Eugène, sachant l’intention et la démarche de ses visiteurs, sut leur démontrer toute la reconnaissance et la gratitude qu’il ressentait au fond du cœur. Ses amis de longue date et lui-même étaient bien conscients qu’ils ne se reverraient plus jamais. Les soins, au chevet de notre père, s’intensifièrent dans les jours suivants.
Qu’aurait fait maman, sans sa grande fille? Pour nous, l’école continuait, même si le drame grandissait à la maison. Là, nous étions à l’abri de cette tension émotive, tandis qu’à la maison, tout était mis en œuvre pour soulager les souffrances assaillant notre père moribond.
Un après-midi de mars, le 17, quelqu’un vint souffler un mot à l’oreille de la maîtresse. Elle s’empressa aussitôt de nous retourner à la maison. À notre retour, il n’y avait personne dans les lieux habituels, la cuisine, la salle à dîner. Le silence régnait, alors nous avons remarqué que la porte de la chambre, où était notre père, demeurait fermée. Tel une grappe de chatons, inquiets, nous sommes restés regroupés, silencieux comme pour faire front commun au drame qui peut-être nous assaillirait d’un instant à l’autre.
Au bout d’un moment, la porte de la chambre s’ouvrit, maman en sortit, s’approchant de nous et voulant nous encercler tous à la fois dans ses bras, elle nous apprit que papa était au plus mal et qu’il fallait avoir une bonne pensée pour lui. Son visage ravagé de fatigue causée par les longues veilles des jours précédents et sa peine interminable ne nous révélaient plus qu’un désespoir démuni de larmes. Elle les avait toutes versées. Nous sommes restés là, complètement abasourdis, par le ton dramatique qu’avait utilisé maman, nous laissant entrevoir l’inévitable. Sans aucune question, le souffle coupé, nous sommes restés immobiles, en silence, sans trop savoir comment réagir à cette situation désespérée? C’était comme si l’on attendait le prononcé d’une sentence qui ferait basculer toute notre vie.
Après le souper, nous fûmes invités à pénétrer dans la chambre de papa. Conscient, peut-être pour la dernière fois, il esquissa un sourire en voyant toute sa famille réunie devant lui, pour un dernier au revoir. Je crois avoir vu une larme rouler sur sa joue. Il ne pouvait parler, mais ses yeux exprimaient tant de choses que nous en avions, pour certains, le souffle coupé. L’effort avait été trop grand pour lui et il referma les yeux. Ce fut la dernière conversation silencieuse, mais combien intense, que nous eûmes tous avec lui. J’en garderai toujours le souvenir. Tous, sans exception, avons récité avec ferveur le chapelet et plusieurs autres prières, espérant un dernier miracle qui n’arriva jamais.
Nous sommes allés nous coucher, ce soir-là, la tête vidée de tant d’émotions, ne nous doutant pas que c’était la dernière fois que nous avions vu notre papa vivant. Il est mort le lendemain matin, vers l’heure du déjeuner. Nous étions tous assis autour de la table quand Marcel sortit précipitamment de la chambre en pleurant et monta, bouleversé, vers sa chambre. Le seul mot qu’il prononça, la gorge nouée, fut: MAUDIT! Depuis ce temps, je n’ai jamais vu pleurer Marcel, sauf lorsqu’il rit de bon cœur.
La sentence, pour nous, venait de tomber; l’âme de la maison s’était envolée pour toujours. Toute la maison semblait pleurer avec nous, les murs, les meubles, tout, quelle tristesse! Ce fut comme un coup de poing nous atteignant au plexus, tous en même temps, nous laissant sans souffle, sans voix. C’était le 18 mars 1953, il avait 56 ans.
Je ne me rappelle pas avoir vu maman au cours de ces moments tragiques. Elle devait cacher sa douleur quelque part dans la maison. Jeanine s’affairait dans la chambre mortuaire et, quelque temps plus tard, nous invita à visiter papa. Il était étendu là, calme, silencieux, irréel, c’était la première fois depuis combien de temps que nous le voyions en paix et le visage détendu, sans souffrances. Dans mon cœur d’enfant, j’étais content pour lui de ne plus avoir à supporter ce calvaire, malgré la peine qui m’envahissait.
Le sentiment de vide ressenti par tous dura jusqu’au moment où Jeanine nous ramena à la réalité. Il ne suffisait pas seulement d’être tristes, il fallait maintenant faire face aux responsabilités qui incombent dans de telles circonstances. Notre père était mort, nous devions procéder aux préparatifs de son exposition et de ses funérailles, sans oublier les corvées domestiques. À chacun des plus vieux fut attribuée une tâche, ce qui eut pour effet de diminuer la tension. Pour ma part, je fus envoyé chez M. Dion, genre de dépanneur situé à quelques quatre milles de chez-nous, acheter toutes les chandelles que je pourrais y trouver. Après avoir attelé le chien, je me mis en route pour le magasin. La température douce avait ramolli la neige du chemin. Le traîneau, tiré par le fidèle chien au galop, je m’éloignai pour un moment de la tristesse et de la tension vécues plus tôt, ce qui me permit de respirer mieux et d’avoir une vision plus claire de ce qui venait d’arriver. Au retour, le train avait été fait, la toilette de notre père était achevée. On l’avait habillé de son plus bel habit. La barbe rasée, bien peigné, vêtu comme pour des noces, il paraissait vivant, on aurait cru qu’il allait nous parler.
Sous les ordres de je ne sais quel spécialiste des funérailles, encore Jeanine sans doute, tout se mit en place avec l’aide de Marcel et de Bertrand. Des tréteaux furent installés dans le salon, on déposa notre père dans un superbe cercueil, venu de je ne sais où, verni et muni de poignées de bronze de chaque côté, garni de satin à l’intérieur. Des chaises furent disposées tout autour et nous avons compris plus tard le pourquoi des cuves de neige dissimulées sous le cercueil… Dès le début de l’après-midi, le salon était redevenu silencieux et prêt à recevoir ceux qui viendraient veiller le corps. Des chandelles brûlaient déjà dans la pièce, laissant monter dans l’air ambiant, des volutes de fumée et une odeur de cire brûlée.
À tout moment, nous regardions si notre père allait se lever et sortir de cette boîte, c’était la première fois que nous étions confrontés à la mort. Il nous fallut un certain temps pour y croire.
Le soir même, les voisins arrivèrent, recueillis pour offrir leurs condoléances et veiller le corps. À partir de ce moment là, notre père ne fut plus jamais seul jusqu’au jour de sa sépulture.
Trois jours durant, il y eut des gens auprès de papa. Dès le lendemain de son décès, je ne sais qui les avait avisés, nous n’avions pas encore le téléphone, une foule de frères et sœurs de mon père et aussi de ma mère débarquèrent à la maison pour pleurer Eugène et consoler Antoinette, qui était à ce moment-là déchirée entre sa peine et le bonheur de revoir des êtres chers.
Selon mes souvenirs, tous ces nouveaux venus nous étaient des inconnus. D’eux tous, émanaient une sympathie et une tendresse immense envers maman et nous tous. Chacun nous adressa la parole, plein de compassion et d’amour. Nous n’avions encore jamais vu une telle marée humaine envahir la maison. Intimidés, nous eûmes tôt fait de nous réfugier comme d’habitude dans l’escalier, serrés les uns contre les autres. De là, nous pouvions tout observer, sans être dérangés. Des conversations différentes se déroulaient partout, dans tous les sens. Chacun profitait du peu de temps qu’il avait pour exprimer son bonheur d’être là, après une si longue absence, parler un peu de sa vie et surtout se regarder, comme pour se réapproprier ces visages tant manqués. Il faut dire que tous ces parents ne s’étaient pas revus depuis des décennies. Il y régnait une intensité et une chaleur que nous n’avions jamais observées auparavant.
À intervalles réguliers, une voix s’élevait et comme par miracle le silence envahissait toute la maison pour la prière. On pouvait réciter une ou deux dizaines de chapelets, dans une ferveur exemplaire. La prière finie, le recueillement durait encore quelques secondes, pour ensuite donner lieu aux échanges fraternels qui ne manquaient pas de rappeler les bons souvenirs d’Eugène, son courage, sa générosité, etc.
Ce soir-là, même si la maison ressemblait à une ruche, nous avons regagné nos lits sans maugréer. Toutes ces émotions nous avaient vidés de notre énergie d’enfants. Emportés par le bruit confus des voix, nous nous endormîmes, alors que les adultes passaient la nuit à veiller notre père, avant qu’il ne quitte définitivement, non pas seulement le cœur, mais aussi les yeux de tous. Le matin, au réveil, le mauvais rêve se révélait encore réalité; notre père était réellement décédé et la maison était encore pleine d’invités. On nous avait annoncé la veille l’emploi du temps de cette dernière journée en présence de notre père et nous étions peu animés du désir de passer à travers cette épreuve. Après un court déjeuner, il y eut une longue prière. Nous sentions la ferveur et la peine dans l’attitude et le regard de tous. Chacun était dans un état de grand recueillement et j’étais sûr qu’ils embrassaient, ensemble, pour la dernière fois, un mari, un frère, un parent, un ami, en cet être aimé et précieux. Alors, pour la première fois, je compris que notre père n’était pas aimé seulement de nous, mais son rayonnement s’étendait beaucoup plus loin que nous pouvions l’imaginer.
Après une dernière et fervente prière, tous les enfants avons été réunis une dernière fois autour du corps de papa en compagnie de notre maman, pour lui dire un dernier adieu. C’est encore Jeanine qui nous adressa la parole, maman ne pouvant sans doute pas prononcer un seul mot, tant son émotion était forte. Elle nous dit que papa était parti au ciel et que nous devions lui exprimer une dernière fois tout notre amour et un chaleureux au revoir. À tour de rôle, nous avons touché sa main étrangement froide en regardant son visage paisible, ne nous doutant pas encore qu’un voile opaque tomberait dans un instant sur un pan énorme de notre histoire.
Le couvercle du cercueil se referma alors, comme une énorme paupière, jetant dans le noir la vie et cette période sombre de la maladie et de la mort de cet être cher. Nous ne nous rendions pas compte encore que nous nous retrouvions seuls.
Il fallut quelques voyages du snow mobile de la maison à l’église pour non seulement transporter le monde, mais aussi le cercueil. On avait endeuillé l’église pour cette triste occasion, chaque statue, chaque décoration, même le chemin de croix et le crucifix avaient été habillés d’un linceul noir, donnant encore une atmosphère plus triste à la situation. C’était froid et humide dans cette église sans doute mal chauffée. On porta le cercueil au pied de la balustrade et le silence devint intense. Nous n’entendions que l’église, qui à son habitude faisait entendre de légers craquements se répercutant partout dans la place. On aurait dit qu’elle s’étirait avant de procéder au travail.
Le père Gallant sortit de derrière l’autel et donna le signal à l’assemblée de se lever. Le froissement qui suivit ressembla, dans ce silence, à un tel vacarme que chacun sortit irrémédiablement de ses pensées profondes. Personnellement, je fus transporté dans un autre monde lors de cette messe de funérailles; la musique vint aussitôt adoucir ma peine et calmer le trouble que je vivais face aux derniers événements. J’étais bercé, non seulement par la présence de cette assemblée pleine de peine et d’amour, mais aussi peut-être par cette certitude que papa était là, tout près, veillant sur chacun comme d’habitude, mais autrement. Toute l’émotion accumulée s’est alors dissipée. J’étais calme. Quelle belle musique, la chorale m’a transporté, c’était la première fois que je ressentais cela.
La messe terminée, on dépouilla le tombeau du voile noir dont on l’avait recouvert et tous suivirent les porteurs vers la fosse, le cœur résigné à la perte définitive tant redoutée. Comme enfant, je ne pouvais imaginer à ce moment l’ampleur et les conséquences d’un tel départ. Le curé s’est avancé au bord de la fosse, lança l’eau bénite et prononça encore quelques dernières prières pendant que nous disions adieu intérieurement. Avant que la terre ne recouvre le cercueil, nous retournions vers l’église juste à côté, où s’opéra la dernière séparation de la journée: toute la parenté retournait au loin. Pour Antoinette, ce fut le dernier déchirement de cet épisode de notre vie. Elle aurait tant eu besoin, encore un peu, du réconfort de ses proches en ces moments douloureux.
Nous sommes revenus à la maison et tous fûrent surpris par le silence et le vide qui y régnait. Une porte venait de se fermer sur la période triste et pénible de la maladie et de la mort de notre père, lesquelles avaient jeté un voile sur tous les beaux moments vécus, depuis tant d’années, ensemble avec lui. Par la suite, personne n’osa plus aborder, sauf superficiellement à quelques occasions, ces sujets qui nous avaient tant fait souffrir. Nous avons enterré avec eux, sans le savoir, de précieux souvenirs de vie fraternelle et de beaux moments heureux.
C’est à cette époque, je crois, que j’ai appris à fermer des portes sur mes douleurs morales, plutôt que d’en parler, de les exprimer. Ce fut peut-être le cas pour plusieurs d’entre nous.
Le jour même, la conscience collective changea. Nous pouvions réaliser, maintenant que papa était parti, que nous devions le remplacer; idée qui ne nous avait même pas effleurés alors qu’il était encore vivant. Les tâches furent distribuées et, sur le champ, nous étions devenus responsables les uns des autres, car nous ne pouvions plus compter sur le géant que fut notre père. J’ai hérité ce jour-là, de l’étable avec Huguette qui quitta peu après, afin d’aller gagner comme aide-ménagère. Jamais nous n’avons pu remplacer papa; même ensemble nous ne pouvions égaler ses succès. C’est pourquoi, lentement, la santé de la ferme se mit à péricliter. Jardin, poules, vaches et cochons perdirent la place importante qu’ils avaient toujours eue, créant ainsi un vide graduel dans les réserves nourrissant la famille. Même si nous donnions notre maximum, le nécessaire diminuait de plus en plus. Antoinette dut vendre les animaux au fur et à mesure que les besoins essentiels se faisaient sentir. Le foin engrangé disparut pour les mêmes raisons; la fatalité nous mettait en face d’une pauvreté sans équivoque. Quelle détermination de la part de cette femme qui, pendant les mois suivants, sans se plaindre, a gratté chaque recoin pour nous assurer le nécessaire vital. De l’intérieur à l’extérieur, elle s’investissait, nous accompagnant dans nos tâches, veillant à tout sans relâche. Combien de fois nous a-t-elle accompagnés à la cueillette des bleuets pour la vente? Aucun moment visible de découragement, toujours vivante et pleine de joie porteuse d’espoir pour nous. Quel miracle! Quelle force!
Le feu est pris
Au cours de l’été 1953, l’année de la mort de papa, la forêt de Sainte-Thérèse prit feu. Cet incendie fut si soudain et féroce qu’il mit en danger la population. Des colonnes de fumée couraient dans la campagne, rendant la respiration difficile et nous soupçonnions que les flammes rôdaient non loin. Les autorités prirent la décision d’évacuer les familles de la campagne et de les reloger ailleurs, les mettant ainsi hors de danger le temps qu’il faudrait. Cet épisode de notre histoire me reste en mémoire parce que c’est la première fois, je me trompe peut-être, que nous sortions du rang 7 pour aller au loin. Sainte-Anne-de-Portneuf, le bout du monde, de notre petit monde. On avait aménagé l’école du village pour nous accueillir, des lits superposés avaient été installés dans les classes et une cafétéria improvisée, mise en place. Toute la famille, ainsi que celles de nos voisins, devait y habiter pour une période que nous espérions la plus longue possible. Antoinette, contrairement à nous, avait assurément déjà hâte de retourner chez elle, avant même son départ de la maison. Cela aurait été de vraies vacances pour nous si les services médicaux du gouvernement ne nous avaient pas retrouvés. En effet, ces briseurs de fun, ont décidé, l’occasion était bonne, d’arracher les dents cariées et aussi de vérifier s’il ne restait pas quelques amygdales toujours vivantes depuis leur razzia précédente. Il faut dire que quelques années auparavant, ils avaient envahi le village de Sainte-Thérèse afin de débarrasser tous les enfants de leurs dents cariées ainsi que de leurs amygdales. Nous nous souvenions qu’à l’aide d’éther, ils nous avaient endormis pour nous enlever et arracher des choses auxquelles nous tenions encore… sans nous consulter. Cette expérience nous avait traumatisés et nous faisait encore peur. Je nous revois, une fois encore, la bouche enflée, incapables de manger à notre goût pendant les jours suivants; de vrais éclopés. Ils n’avaient donc aucun respect pour les vacances!... Et les enfants!...
Les vacances furent abrégées subitement et l’enflure toujours visible à notre retour à la maison. La pluie avait eu raison du feu. La vie reprit son cours et nous, pleins de souvenirs nouveaux, pouvions rêver à cette aventure, combien grandiose, même si elle fut décevante à certains égards et de trop courte durée.
Il n’était pas rare de voir des feux de forêt éclater, même en ces temps éloignés. Ils pouvaient être très destructeurs, vu le manque de moyens pour les combattre. À la même époque, la ville de Rimouski, de l’autre côté du fleuve, à environ trente milles de distance, eut à subir un incendie si féroce que la moitié des maisons brûlèrent. Depuis chez nous, nous voyions la fumée s’élever, avec la désolation des résidents. Ce fut une grande catastrophe dont on parla longtemps.
Il faut prendre une décision
Maman réalisa avec le temps qu’elle ne pourrait mener à terme le projet porté en son cœur depuis la mort d’Eugène: continuer la mission. Elle se rendit compte que la fin de cette énergie approchait et qu’un jour ou l’autre, elle n’en pourrait plus; avec tout ce que cela représentait comme conséquences. Sainte-Thérèse devenait, après avoir répondu à tant de rêves, un cauchemar, un danger pour la survie des enfants. Il fallait se résigner, pour le bien de tous, à changer quelque chose.
Avec l’aide de Marcel et Bertrand, elle décida de quitter Sainte-Thérèse pour aller tenter ailleurs d’assurer une vie meilleure à tous. Alors, les deux aînés trouvèrent, non loin de Forestville, une petite ferme à Paul-Baie, qui pourrait nous rapprocher des écoles du village et assurer la présence des grandes sœurs et frères les fins de semaine afin de la supporter. Marcel et Bertrand cautionnèrent cet emprunt pour ma mère qui, à son tour, s’engagea à leur rembourser mensuellement l’argent ainsi prêté. Elle réussit à remettre la totalité de la somme au cours des années suivantes. Le déménagement se fit le 26 mai 1954.
Jeanine en amour
Un événement inhabituel et tellement important pour moi et la maisonnée arriva, alors que nous vivions encore à Sainte-Thérèse, et je me dois de le souligner: Jeanine «tomba» en amour. Cette nouvelle attira immédiatement notre curiosité puisque c’était la première fois qu’une telle chose arrivait dans notre famille. Nous avions vu nos sœurs effeuiller la marguerite rêveusement mais cette fois, c’était vrai. Nous étions en même temps curieux et un peu craintifs; c’était un étranger. Quand il se présenta à la maison avec ma sœur, je ne sais pas pour les autres, mais je peux dire que j’ai eu le coup de foudre. Un grand homme charmant qui s’intéressait à chacun de nous, apportant des caisses de pommes, de l’orignal, de la truite et surtout, nous amenait faire des randonnées dans son immense auto verte. Il nous avait montré à compter en anglais jusqu’à dix; je vois encore le visage envieux des autres élèves de l’école lorsque nous leur avons parlé de René et que nous avons compté en anglais orgueilleusement devant eux! Que demander de plus au «chum» de Jeanine? Cette rencontre introduisait en nous la notion que nos frères et sœurs pourraient, un jour, à leur tour être amoureux et apporter de nouveaux visages à la maison, ce qui présageait de belles rencontres. Heureuse, Jeanine souriait de nous voir nous entendre si bien avec lui.
Paul-Baie, 1954
De Sainte-Thérèse de Colombier, le déménagement mentionné plus haut se déroula un beau jour de printemps dans un rang de campagne que l’on nommait alors Paul-Baie. Quelle période de bouleversements! Il fallait tout ramasser ce qui serait encore utile, vider la maison, penser aux meubles, ne rien oublier. Tout était si rapide, nous n’avions pas le temps de réaliser ce qui arrivait. Sans que l’on s’en rende compte, nous nous sommes retrouvés ailleurs, comme par enchantement. Une grande maison, impressionnante, composée de neuf pièces, nous accueillit. D’abord, l’entrée donnait sur une immense cuisine où l’on pouvait installer table et chaises pour les repas et il restait encore de la place. Une porte à gauche s’ouvrait sur une grande pièce séparée par une porte d’arche. C’étaient la salle à manger et le salon. Ces mêmes pièces débouchaient sur deux chambres. Un escalier nous amenait au deuxième, abritant trois autres chambres. Jamais nous n’avions vu tant d’espace. Quelle richesse! Dehors, une tour avec un engin à hélice attaché au-dessus trônait à l’extrémité de la cour. Tout près, une cabane étroite, munie d’une seule porte, sans fenêtre, excita notre curiosité. C’était la toilette de dehors… Quelle surprise pour nous qui avions l’habitude d’aller au grand air, au soleil, dans le petit sentier à côté du cran! Nous avons dû nous habituer à faire ça, dorénavant, à l’ombre et sans témoins.
Une grange et une étable s’élevaient en face de la maison, où nous conduisîmes la seule vache qui restait ainsi que la quinzaine de poules encore vivantes. On mit le tracteur dans la grange, où il dormit des années durant. Comme nous avions déménagé au printemps, nous dûmes aller à l’école du rang, et ce ne fut pas un succès. Le déménagement et tout le dérangement me détournèrent irrémédiablement de la concentration nécessaire pour étudier. C’est peut-être la période la plus difficile, au niveau financier, que nous ayons vécue. Je me rappelle qu’alors, j’étais habillé des pantalons que mon père avait portés, ceux-ci, genre police montée à cheval étaient kaki avec des côtés énormes et le bas des jambes très serrés. Une chance que je ne me voyais pas! Cette culotte n’avait plus de boutons et la fermeture éclair était brisée; j’avais attaché le tout avec un clou. La maîtresse m’avait mis en garde contre les blessures éventuelles. Ce fut une fin d’année gâchée sur toute la ligne.
Une séparation douloureuse, 1954
Tout ce déménagement avait engendré un tourbillon emportant avec lui toutes les énergies d’Antoinette. Je crois qu’elle avait atteint le niveau, où l’on s’approche dangereusement du désespoir. Comment surmonter cette misère? Cette question devait la poursuivre sans cesse. Je ne sais qui la conseilla, mais pour soulager cette inquiétude constante, elle décida, à contrecœur, j’en suis convaincu, de laisser aller quelques-uns de ses enfants, temporairement, dans ce que l’on appelait alors un orphelinat. Notre mère était une femme d’une fierté peu commune et il fallait que la situation soit devenue invivable pour qu’elle en arrive là. J’ignore comment furent choisis ceux qui partirent et j’essaie aujourd’hui de me mettre à leur place et de comprendre ce qu’ils ont pu ressentir à la nouvelle de ce départ. Quelle inquiétude devant l’inconnu, seuls, sans personne pour les accompagner, les protéger. Pouvaient-ils juste comprendre et accepter les motifs de cette décision? Je peux imaginer qu’ils ont dû, souvent, se demander s’ils reverraient les leurs. Colette, Madeleine, Jean-Marie et Yvon ont ainsi partagé à leur façon les efforts de tous pour sortir de cette affreuse misère. Quelle soumission de leur part et quel renoncement de la part de maman et de nous tous; ne plus partager notre vie et notre amour avec ceux de qui nous n’avions encore jamais été séparés. C’était comme si on nous avait amputés d’une partie de nous-mêmes. La maison était vide et sans vie.
Au cours de l’été, on nous avisa de la fermeture de l’école du rang et dorénavant, tous les élèves devraient fréquenter celle du village. Un autobus viendrait nous prendre le matin et nous ramener le soir après la classe. Cet épisode fut pour nous une bénédiction. Au niveau scolaire, en effet, nous nous retrouvions dans des classes à un seul niveau, où tous les élèves apprenaient la même chose en même temps. Moi, j’entrais en cinquième année et là, je commençai à aimer l’école, à comprendre et à réussir.
La vie à Paul-Baie
Au cours de cette année, chaque jour après l’école, je m’occupais de la vache et j’allais couper un arbre sec dans le bois pour chauffer le poêle. Cette corvée pouvait durer une ou deux heures, selon le cas. Je revenais le traîneau plein, heureux de contribuer au bien-être de tous et je pouvais ensuite entrer souper. Après, venaient les devoirs et l’étude avant une nuit de sommeil bien méritée. Les jours passaient tous semblables, trop remplis pour même s’ennuyer. Lise, Denise et Michel formaient un petit clan ne faisant pas trop de bruit. Ils étaient gentils et mettaient un sourire aux lèvres de maman qui commença à reprendre vie après tant de lourdes inquiétudes et préoccupations. Le printemps venu, la vache eut un veau, ce qui fut toute une surprise pour moi, n’ayant jamais été témoin d’un tel événement. Éberlué, je ne pouvais comprendre d’où pouvait venir un veau dans l’étable. Je compris que notre vache avait réalisé ce que toutes les autres vaches que j’avais connues avant elle, vêler au printemps venu. Ce ne fut pas là la fin de mes surprises: je remarquai, sur le sol, non loin, un genre de grand béret rose. Je m’approchai, d’abord méfiant, et le poussai du bout du pied. Je m’aperçus que ce n’était pas vivant et que c’était un genre de sac très mou. Je résolus alors de sortir cette chose de l’étable. J’appris alors qu’un placenta de vache ne se laisse pas attraper aisément. J’eus beau le coincer dans un coin de la pièce, il réussissait toujours à rouler hors de la pelle. J’essayai de trouver un outil adéquat, rien n’y fit. Alors, je le roulai, à la main, vers la porte et réussis enfin à éjecter l’intrus dehors. Maman répondit, après coup, à toutes les questions que cet événement m’avait posées. J’avais réussi, ce jour-là, à coups d’efforts et de surprises, à pénétrer les mystères de la vie.
Je dus commencer à traire cette nouvelle maman et soigner le nouveau venu. Je ne saurai jamais si, après la traite, il restait encore du lait dans son pis. On ne m’avait pas montré à traire. Je faisais de mon mieux. Maman s’en était peut-être rendu compte puisqu’elle vendit cette même vache et son veau peu de temps après. Je ne m’en plaignis pas. Pour ce qui est des poules, je dois avouer, maman ne l’a jamais su, elles ont atterri les unes après les autres sur le tas de fumier, au cours de l’hiver. J’ignorerai toujours ce qui leur arrivait, mais deux ou trois d’entre elles se retrouvaient sur le côté, mortes, à chaque semaine. Pour ne pas alarmer maman, je gardais le silence sur ces tragédies. Comme elle avait bien d’autres préoccupations, elle a dû oublier qu’au départ, nous avions une quinzaine de poules bien vivantes.
Une location inattendue
Un jour, Bertrand arrive et demande à notre mère si l’un de ses amis peut résider chez nous moyennent une certaine rémunération. Il mentionne que cet homme travaille avec lui et qu’il emménagerait avec son épouse et sa petite fille. Maman dit oui immédiatement. Dans sa situation, elle ne pouvait refuser. Cette petite famille prit une des chambres du bas et occupât le salon et la salle à dîner. Ce fut pour nous, les enfants, une belle expérience, puisque cet homme et sa petite famille étaient gentils et généreux avec nous. Ils restèrent une année. Quand vint l’été, ils partirent, le mari ayant été transféré.
Jeanine se marie, 1954
Nous nous doutions tous qu’un jour, Jeanine se marierait avec son beau René. C’est ce qu’elle fit au cours du même été, le 28 août 1954. Quel branle-bas, à la maison: nous ferions la noce dans le salon de notre maison de Paul-Baie. Je me souviens de la nervosité de maman et des filles plus âgées devant l’ampleur des démarches à faire, surtout que Jeanine était la première à s’aventurer ainsi. Le repas, les faire-part, les invités, le photographe et j’en passe, rien ne fut oublié.
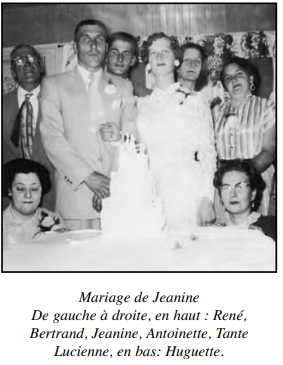
Je revois encore la quantité de nourriture qu’il fallut pour le repas; je n’avais jamais rien vu de pareil. Enfin, le grand jour arriva. Jeanine et Huguette avaient sans doute contribué, car nous avions des vêtements neufs pour l’occasion. Elles avaient aussi demandé à maman de nous aviser qu’elles ne toléreraient pas de bêtise lors du repas. Il faudrait être poli et le meilleur moyen d’être correct était de suivre ce que faisaient les autres: surtout, ne pas sauter sur la nourriture comme des c…
Quelle surprise extraordinaire de voir Jeanine descendre du haut des marches, dans l’escalier, vêtue comme une reine, d’une longue robe blanche, resplendissante de beauté et de bonheur! Nos yeux n’étaient pas assez grands pour tout saisir. Elle avait l’air d’un ange. Une auto attendait pour amener la mariée ainsi que notre mère à l’église. Puis le cortège s’éloigna dans un nuage de poussière, il n’y avait pas d’asphalte à Paul-Baie. Vous ne pouvez pas savoir combien nous aurions voulu être du voyage! Mais nous ne fûmes pas invités: trop petits...
Nous n’avions encore rien vu: le comble fut de voir revenir une file interminable d’autos klaxonnant à tue-tête et s’immobiliser dans la cour. Il y en avait tant qu’il n’y avait plus de place. René et Jeanine, radieux, sortirent les premiers, suivis de maman, de Marcel, Bertrand et Huguette, sur leur «trente-six» eux aussi. Une foule d’invités emboîtèrent le pas jusqu’à l’entrée, où fut prise une première photo, et beaucoup d’autres ensuite. Nous, les enfants, trouvions cette séance de photos beaucoup trop longue, car nous avions hâte de nous empiffrer… poliment, de toutes les bonnes choses que nous avions vues défiler depuis la veille. Enfin, chacun prit place autour de cette table allongée pour l’occasion. Je me souviens avoir été placé non loin de M. Langelier, le patron de Jeanine et propriétaire de l’hôtel des Quatre Chemins. C’était un homme qui inspirait le respect et je décidai de l’imiter pour ne pas faire de gaffe au cours du repas. Au bout d’un moment, il tendit la main et prit un fruit dans un plat que je surveillais depuis un bon moment et qui me semblait succulent; la faim aidant, le ventre commençait à me gargouiller. J’attendis un instant et à mon tour, je tendis la main et pris entre mes doigts cette petite merveille ronde et fraîche et la mis délicatement dans ma bouche. Je n’eus pas le temps de savourer, je ressentis aussitôt un goût acide, intolérable et, sur le champ, je crachai cette chose infecte dans ma main et n’ayant d’autres recours, sans que cela paraisse, la camouflai dans ma poche. J’ai su après le repas n’avoir pas été le seul à vivre cette expérience. Nous avions mangé notre première olive! Comme les autres, j’ai été sur mes gardes tout le long du repas. Il va sans dire que le reste était délicieux. Il y eut quelques discours, des embrassades à chaque fois que l’on faisait teinter les coupes et le fameux gâteau de noces avec ses trois étages de crémage, quel délice!
Par la suite, nous considérions René comme faisant partie de la famille. Chaque fois qu’il venait à la maison avec notre grande sœur, c’était la fête.
Bertrand débarque
Bertrand avait presque toujours travaillé au loin. Un jour, il trouva un emploi plus près de la maison et par conséquent, il s’installa chez nous pendant environ un an. Nous en étions heureux, car sa compagnie était plaisante, remplie d’humour et surtout, toujours remplie de bonne humeur. Sa présence fut fort utile à notre mère ainsi qu’à nous tous. Il se faisait un immense plaisir de nous transporter au village dans son vieux camion pick-up Fargo, généralement pour des courses et surtout pour les offices religieux. Son travail consistait à installer des tours transportant l’électricité de la Côte-Nord vers la ville. Il était chef d’équipe et très apprécié de tous ceux qui avaient la chance de travailler à ses côtés. Plusieurs années plus tard, on parlait encore de lui, comme d’un travailleur infatigable possédant des qualités incontestables de leader.
Son pick-up Fargo était tout ce qu’il y a de plus rudimentaire. Ce véhicule avait la tête aussi dure que son propriétaire. Quand il refusait de partir, il n’y avait que Bertrand pour l’amadouer et lui faire entendre raison. En hiver, ce véhicule était aussi frileux qu’un mouton frais tondu. Les matins froids, il ne voulait rien savoir du doigté de son maître. C’est alors qu’en se présentant dans l’encoignure de la porte, il me disait avec ce sourire qu’on lui connaît: «encore une fois?» Cela voulait dire, viens me pousser, il ne veut pas partir. Je sortais dans le froid sibérien de ce coin de pays, à environ moins trente, lui, assis au volant me faisait signe de pousser. Il faut dire que la veille, il avait pris la précaution de placer son véhicule dans une petite descente, en face de la maison, au cas où... De toutes mes forces, je réussissais à bouger ce camion qui était devenu, en quelque sorte, un genre d’ami bougon. Après avoir atteint une certaine vitesse, Bertrand lâchait la pédale et alors, dans un frissonnement et une toux timide, ce lourdaud se mettait à cracher une fumée ininterrompue par le tuyau d’échappement pour nous signifier son accord. Combien de fois avons-nous répété les mêmes gestes complices, face à ce capricieux aux sentiments à fleur de peau!
Bertrand fut toujours pour nous un peu énigmatique; pince-sans-rire, subtilement taquin, il était d’une grande générosité, toujours prêt à rendre service. Rêveur sur les bords, curieux, cherchant toujours à trouver le secret des choses, il était notre sécurité et souvent notre réconfort.
Ce printemps-là, Marcel me fit cadeau d’un voyage de camion rempli de belles bûches de bouleau bien rondes que je devrais fendre assurément. Ce tas de bûches ressemblait au mont Everest, le cœur me manquait juste à le regarder; dans ma tête, je me voyais déjà à la retraite avant d’avoir fini! Puis j’appris que l’on ne fend pas une montagne de bois, on fend une bûche l’une après l’autre. Ce que je fis. J’ai bien dû passer quelques mois à grignoter cette montagne jusqu’au dernier rondin. Ce fut ma première grande victoire. Comme il n’y eut personne pour fêter avec moi, je me félicitai moi-même, car j’en ressentais une immense fierté.
Voilà les pensionnaires
Je dois raconter qu’aux vacances d’été, Colette, Madeleine, Jean-Marie et Yvon sont revenus à la maison. Quel bonheur de les revoir et de les entendre raconter leurs expériences lointaines! Assis autour d’eux, nous tentions d’imaginer les décors, la vie et les péripéties qu’ils avaient vécues. Ils étaient au début comme de la visite, mais bientôt, la vie reprenait comme avant. Au cours de cet été-là, Colette réussit à convaincre maman que la vie de pensionnat n’était pas pour elle. Je ne sais pas ce qu’elle lui a promis, mais elle ne partit pas avec les autres en septembre. Encore une fois, la maison se vida, l’automne venu, apportant les déchirements de l’année précédente.
La vie habituelle reprend
Pendant ce temps, la vie passait, et les besognes quotidiennes venaient nous faire oublier les tristesses et les regrets accumulés. L’école remplissait notre vie ainsi que les responsabilités domestiques, ne laissant aucune place pour nous apitoyer sur notre sort.
Je dois remercier maman pour les efforts qu’elle a déployés afin de m’inciter à faire mes devoirs et apprendre mes leçons chaque jour que Dieu amenait. Que de fois, épuisé, je serais allé au lit en omettant le travail scolaire. Elle insistait tellement que je le faisais sans doute en maugréant, mais le faisais quand même. Aujourd’hui, je reconnais que sans elle, je n’aurais pu poursuivre des études avancées, car j’aurais été incapable de répondre aux exigences des examens d’admission. Je vois à quel point les petits gestes accumulés peuvent parfois se révéler primordiaux pour la réussite d’une vie. C’est le plus beau cadeau que maman m’ait laissé.
Huguette, pendant ce temps, avait gradué d’un emploi à l’autre pour se retrouver vendeuse au magasin La Baie d’Hudson de Forestville. Quelle fille généreuse! Jamais, elle ne revenait à la maison sans une petite attention pour l’un d’entre nous. Parfois, c’était pour notre mère, à d’autres occasions, Lise, Denise et Michel, son filleul le plus gâté, faisaient l’objet de ses largesses. Enfin, tous y passaient. Je me souviens qu’un jour, elle débarqua avec un manteau, une canadienne, qu’elle me tendit en disant: «c’est pour toi.» Cela faisait au moins deux ans que j’enviais mes confrères de classe pour leurs beaux vêtements, convaincu de ne jamais en posséder de pareils. Comment avait-elle pu deviner mon désir secret? Huguette était comme ça; elle comprenait les besoins des autres sans qu’il soit nécessaire de les exprimer. C’était un bonheur pour elle de donner. Quel grand cœur! De nous voir heureux la remplissait de joie et c’était merveilleux de la voir rire en ces heureuses occasions. Je crois que le Bon Dieu s’est trompé le jour de sa naissance, il a échappé, par mégarde, un ange.
Avec Jeanine, elles ont, par l’amour qui les habitait, réussi à soutenir maman dans les moments les plus difficiles. C’est de l’affection et surtout de l’admiration que nous ressentons pour elles après tant d’années.
Ce fut par la suite le tour d’Huguette de «tomber en amour». Gonzague Canuel fut l’heureux élu. Je crois qu’il avait préparé le terrain depuis longtemps… il conduisait une niveleuse, c’était facile pour lui et Huguette s’est laissée aimer sans résistance. Un nouveau beau-frère, surtout Gonzague que l’on connaissait bien, il était l’ami de Marcel et de Bertrand depuis des années, c’était de bon augure. De plus, cet homme jouissait de la renommée d’être le plus fort de la région; nous étions flattés de l’accueillir dans la famille. Il avait un caractère affable, toujours souriant et serviable; que demander de plus? Et par surcroît, presque chaque année il faisait l’acquisition d’une auto neuve et rutilante. C’était le grand amour, ça se voyait dans leurs yeux et leurs gestes. Un autre mariage fut donc à l’agenda pour l’été suivant.
Cet été-là sonna le retour définitif de Madeleine, Jean-Marie et Yvon. La maison reprenait ses couleurs habituelles, tout le monde était là. Michel allait maintenant à l’école, Lise et Denise avaient grandi, et comme des jumelles, étaient toujours ensemble, belles et délicates comme elles sont restées aujourd’hui. Enfin, nous étions devenus plus responsables et conscients de la vie qui nous entourait. Jean-Marie et Yvon pouvaient me suivre, partager mes tâches et aussi mes mauvais coups. Il ne fallait pas se faire prendre et c’était la loi du silence. Que de plans avons-nous développés ensemble; la grange fut témoin de bien des exploits assez souvent soldés par des larmes. Nous étions complices et cette complicité nous rendait pleins de bonheur. Les bains dans la rivière, les grottes creusées dans la coulée, les feux de camp, la pêche, tout nous semblait possible et cette liberté nous en avons profité jusqu’au bout. Quels beaux moments! Quels beaux souvenirs!
Je ne peux m’empêcher de raconter cette anecdote. Notre mère était partie, je ne sais où avec Marcel et c’était toujours à ces moments là que nous en profitions pour faire des expériences que maman n’aurait sans doute pas acceptées. Il y avait dans la cour un de ces grands râteaux, tiré habituellement par un cheval. Il était équipé d’une pédale faisant lever les dents à chaque fois que l’on appuyait dessus. L’idée est venue de qui, je ne m’en souviens plus… certainement pas de moi… de tirer le râteau et le faire fonctionner. Bien entendu, il fallait un membre du groupe chargé d’appuyer sur la pédale. Yvon semblait le candidat idéal et c’est lui qui prit place sur le siège. Une fois qu’il fut bien installé sur son trône, Jean-Marie et moi partîmes à toute vitesse avec cet engin, sans nous soucier d’Yvon. Au bout d’un certain temps, nous lui avons crié : «Vas-y, pèse sur la pédale!» Nous fûmes surpris de ne rien entendre derrière. Nous nous sommes arrêtés et quelle ne fut pas notre surprise de voir le siège vide. Yvon était par terre; il était tombé de son siège et nous avions passé dessus avec la roue du râteau. Après l’avoir relevé et consolé, nous lui avons fait promettre de ne pas en parler à maman. Motus et bouches cousues!...
Combien de fois avons-nous essayé de nouvelles expériences défendues, qui n’ont pas toujours bien tourné et ont occasionné parfois une larme ou une bosse! Ça en valait la peine pour l’expérience et surtout pour les souvenirs qui nous restent.
À plusieurs occasions, alors que nous partions pour la pêche au ruisseau de Paul-Baie, Michel, qui n’avait alors que cinq ou six ans, voulait nous suivre et nous savions fort bien qu’il ne pourrait aller si loin, vu son jeune âge. Comme il courait derrière nous et ne voulait pas lâcher prise malgré nos ordres de retourner à la maison, nous l’attrapions et lui mettions un billot assez gros sur le ventre afin qu’il ne puisse se dégager. Alors, il se mettait à pleurer et crier, alertant maman qui venait le dégager. Pendant ce temps, nous avions déguerpi. Aujourd’hui, il faudrait un arbre complet pour le retenir, vu sa force physique et son amour de la pêche.
Des anecdotes comme celles-là, nous en avons vécu de multiples; elles faisaient partie de nos vies. Se remémorer de si beaux souvenirs fraternels ne peut que nous rapprocher.
Huguette se marie, 1956
L’énervement causé par les préparatifs du mariage d’Huguette fut moins grand puisque nous avions déjà vécu celui de Jeanine, mais une certaine fébrilité régnait toutefois dans la maison. La future mariée, elle, ne semblait pas s’en faire outre mesure; en effet, la veille de son mariage, elle m’invita à partager la corvée du lavage et du cirage de l’auto de Gonzague. Elle devait être impeccable. Huguette n’était jamais pressée. Je crois qu’il nous fallut l’après-midi au complet pour frotter, astiquer et surtout faire briller le chrome de ce joyau qui les conduirait le lendemain.
Encore une fois, nous les plus jeunes n’avons pas été invités à l’église pour la cérémonie du mariage. Avec l’expérience acquise l’année précédente, nous avions bien hâte de nous régaler, mais étions surtout impatients de voir revenir les mariés accompagnés du tintamarre des klaxons. Les invités innombrables, ce tourbillon humain et tout ce brouhaha joyeux nous enivraient. Gonzague, habillé comme un avocat, souriait de toutes ses dents comme s’il avait gagné la coupe Stanley et Huguette, sensible et radieuse, semblait transportée de bonheur. À quelques reprises, je l’ai vue essuyer une larme furtive, révélant sa grande émotion face à ce bonheur tant attendu.
Le repas fut aussi délicieux que celui de l’année de noce précédente. Cette fois-là, nous en sommes sortis les poches vides, nous avions vite repéré les olives.
Gonzague emménagea avec Huguette à Forestville dans une maison de la compagnie pour laquelle il travaillait: l’Anglo Pulp and Paper. C’est là que naquirent leurs premiers enfants.
Gonzague était à l’emploi de la compagnie forestière de l’endroit. Sa tâche consistait à entretenir le chemin menant à l’intérieur de la forêt, jusqu’aux coupes de bois. Il conduisait, pour ce faire, une de ces machines ressemblant à une immense sauterelle rouge, traînant une pelle métallique sous son ventre pour égaliser le gravier: une niveleuse. Il était le roi de la route, connaissant tout le monde et ayant des relations chaleureuses avec tous. Sa belle personnalité le faisait aimer de tous. Il était un mordu de la pêche et il connaîssait les meilleurs endroits pour assouvir sa passion. La chasse faisait aussi partie de ses activités préférées. Comme tout bon pêcheur, il ne dévoilait que rarement ses meilleurs coins.
Étant encore minuscules, mes frères et moi avions beaucoup d’admiration pour ce géant généreux et affable.
Je ne m’en doutais pas encore, mais cet été-là serait le dernier que je passerais avec mes frères et sœurs à la maison. Ce fut le dernier été où nous sommes allés ramasser des bleuets. Maman nous accompagna tout au long de la saison, sans doute pour nous encourager. Sa présence était très appréciée. Nous allions surtout avec un voisin du nom de Foster possédant un camion pour nous transporter aux champs de bleuets. Il fallut bien sûr faire aussi les foins; une petite prairie en produisait encore et notre mère décida de le faire couper pour le vendre. C’est mon oncle Gustave, son frère, qui eut la générosité de s’offrir pour faucher et engranger la récolte. Je fus, pour l’occasion, requis comme aide aux travaux. Ce jour-là, il y eut tellement de moustiques que nous dûmes nous recouvrir la tête de vieux bas de nylon qui nous faisaient ressembler étrangement à des voleurs de banque. C’est devant le miroir, à la fin de la besogne, que nous sûmes pourquoi maman et Jeanine étaient mortes de rire. Nous étions si laids qu’aucun maringouin ne nous toucha de toute la journée. Cet oncle Gustave était un véritable Langlois, plein d’humour et de joie de vivre. Il est souvent venu prêter main-forte à la maison après la mort de papa. Il était soucieux du bien-être de sa sœur et de nous tous. Ce fut un autre personnage important qui m’a marqué par la constance de sa générosité.
On aurait dit que nous savions, je ne sais par quelle prémonition, que cet été serait le dernier été partagé mes frères et moi. Que de parties de pêche à la chute et au bout de la terre! L’automne venu, quel plaisir de poser des pièges à vison et quelle surprise joyeuse que d’en attraper. Nous avons cueilli des noisettes, pour la première fois, et ce furent nos derniers mauvais coups exécutés dans la grange. Un jour, nous avons élaboré un plan pour mettre fin aux souffrances d’une vieille chatte malade. Michel en fut le bourreau, nous avions tous trop peur! La construction d’un ascenseur à l’aide d’un vieux chaudron fit dégringoler Yvon en bas de la tasserie, «le fenil»; le sommier remisé dans la grange, devenu balançoire de quelques minutes, jusqu’à ce que maman nous surprenne; et combien d’autres machinations. C’était la liberté, le bonheur d’être ensemble et la chaleur d’une relation fraternelle heureuse ineffaçable. Au cours de l’année scolaire, on remarqua sans doute que j’étais un bon garçon et on m’enrôla dans les Croisés. C’était un regroupement religieux pour les jeunes, organisé par les frères. Je devais assister aux réunions se tenant à l’école et faire le trajet d’au moins quatre ou cinq kilomètres à pied, juste à l’aller, et ce une fois par semaine. J’ai réussi à convaincre Jean-Marie de faire partie du même groupe. Nous avons fait le trajet tout l’hiver. Je me rappelle que nous partions après le souper pour revenir tard le soir; il fallait y croire…
Marcel tombe en amour à son tour
Au printemps de cette année-là, Marcel et Bertrand durent s’exiler dans la région de Montréal pour leur travail. Tous deux étaient à l’emploi d’une compagnie installant des tours de transmission électrique. Bertrand construisait, tandis que Marcel conduisait un tracteur. Durant son séjour là-bas, il rencontra son âme sœur en la personne de Louise Lalande. Ce fut le coup de foudre puisqu’ils se marièrent à l’automne 1956. Pour nous, les plus jeunes, s’annonçait une nouvelle expérience, nous aurions à fréquenter une belle-sœur, cela créait une curiosité certaine.
La cérémonie du mariage eut lieu dans la région de Montréal et il n’y eut que notre mère et je ne sais combien de nos sœurs accompagnées de Bertrand qui assistèrent au mariage. Je me souviens de la fierté de notre mère à son départ pour la «grande ville». Elle était fière de marier son plus vieux, disait-elle.
Louise était déjà venue nous rencontrer, aussi, nous la connaissions déjà. Le projet de Marcel et de Louise fut de venir demeurer avec nous à Paul-Baie. Au cours des années suivantes, nous avons cohabité avec eux et ce fut, du moins pour moi, une des années de découvertes inoubliables. Louise arriva les malles chargées de disques de musique classique de toutes sortes. Des opéras, des opérettes, du piano, du violon, de quoi faire rêver un mélomane. Je n’étais pas initié à la musique, mais juste le fait d’entendre ces enregistrements m’a fait entrer en contact avec un art qui m’a suivi le reste de ma vie. J’avoue aujourd’hui avoir cassé un de ces disques, un soir, alors que Louise était sortie avec Marcel. Je m’en excuse auprès d’elle, je fus bien puni, puisqu’il était mon préféré. Elle avait apporté avec elle un piano extraordinaire… mécanique, il jouait en déroulant des cylindres, ce qui actionnait les notes.
Louise nous apprit beaucoup de notions sur la ville et nous avons découvert une autre sœur en elle. Généreuse, elle a souvent aidé maman à coudre ou tricoter pour nous vêtir. Compréhensive et attentionnée, elle savait écouter nos propos. Elle démontra une grande capacité d’adaptation à une culture campagnarde, qui devait souvent la surprendre, sinon la scandaliser. C’est avec le sourire qu’elle s’est adaptée à tout cela; avec le temps, ces expériences frappantes se sont transformées en humour. Son amour pour notre frère a été indéfectible et elle a contribué au bonheur de tous ceux qui l’ont entourée. Elle joua un rôle important au sein de notre famille.
C’est le tour de Bertrand de rencontrer Cupidon en 1957
Bertrand n’a pas mis de temps, après Marcel, à se lier à une compagne: Irma Jauvin, une amie de Louise. Discrètement, il l’a courtisée, et soudainement bang!, ils s’épousèrent. Comme à son habitude, il a toujours aimé faire des surprises. Le mariage se déroula dans la région de Montréal et, bien entendu, sauf maman et peut-être quelques autres fortunés, dont Marcel, y ont assisté; nous n’avons pas été invités. Ils s’installèrent à Forestville et comme deux tourtereaux ont filé le parfait bonheur. Irma était rieuse et très amoureuse de son Bertrand. Elle avait un talent indéniable pour la cuisine et les travaux domestiques, comme la couture et la décoration. Leur porte nous était toujours grande ouverte, leur générosité et leur accueil étaient exemplaires. Irma et Bertrand demeurèrent à Forestville au cours des années suivantes, non loin de la maison maternelle.
La modernité
Au cours des trois années passées à Paul-Baie, nous avons connu des événements bouleversant notre mode de vie; en effet, quand nous sommes arrivés pour habiter cette ferme, il n’y avait ni électricité, ni téléphone. L’eau provenait d’une pompe à bras qu’il fallait actionner chaque fois que nous en avions besoin. Un jour, durant la première année, on nous avertit que nous aurions l’électricité. Une fois les poteaux alignés à travers champs, les fils furent suspendus et l’on «brancha» la maison. Comme les anciens propriétaires avaient une éolienne et que les fils circulaient déjà dans les murs, en moins de deux la magie s’opéra pour nous: la lumière instantanée, les multiples outils culinaires, l’eau courante, et même la toilette! Ce fut toute une révolution pour nous qui n’avions pas connu ce miracle de la technologie. Je me souviens, au début, avoir actionné l’interrupteur de la lumière des dizaines de fois juste pour vérifier si je ne rêvais pas. J’ai réalisé, à la longue, que le système était fiable et le tout s’est imposé graduellement comme une nécessité, me faisant oublier les corvées d’un passé, pourtant très récent.
Le téléphone, aussi, est venu s’implanter dans notre campagne. Encore une fois, quel enchantement que de pouvoir parler à distance et d’entendre la voix des gens. Pourtant ces installations étaient très rudimentaires; je me souviens, le téléphone ne sonnait pas que pour nous; chaque résident avait sa tonalité, comme du morse. L’un pouvait avoir un grand coup et deux petits coups, l’autre, un seul grand coup, et le tout sonnait dans toutes les maisons. Il fallait être attentif pour ne pas prendre les appels des autres, et pour ne pas manquer les siens. Le plus comique, c’était de voir mes sœurs et maman s’offusquer de savoir que quelqu’un écoutait leurs conversations, à leur insu. J’ai aussi vu quelques-unes d’entre elles faire de même! Les nouvelles allaient vite! Malgré les désagréments, ces appareils ont permis à notre famille d’entrer dans l’ère moderne et de rattraper le reste de la province bénéficiant depuis longtemps de cette technologie. On était loin d’imaginer qu’un jour on parlerait d’Internet et de courrier électronique. Cette transition s’est faite sans heurts et nous a permis de passer, en quelques années, d’une culture vieille de quasiment deux siècles à celle des temps modernes. Quand cela apporte du bien-être, on s’adapte vite.
La culture et la famille
Malgré la distance des milieux culturels québécois, il a toujours régné à la maison une vie culturelle très vivante. Notre mère a contribué par ses connaissances musicales à maintenir notre goût pour la musique, même si personne d’entre nous n’est devenu musicien. Elle connaissait de multiples refrains qu’elle chantonnait constamment et elle avait dans ses trésors les cahiers de la Bonne Chanson. Elle se plaisait à nous enseigner les chants et romances qu’on y trouvait. De plus, un appareil de radio, alimenté par une batterie, le seul lien avec le reste du monde, nous faisait entendre les dernières trouvailles musicales québécoises et françaises. Notre plaisir était d’écouter Tino Rossi, Luis Mariano, Maurice Chevalier, Félix Leclerc, et tant d’autres qui ont bercé notre enfance.
Maman nous faisait écouter aussi, parfois bien malgré nous, les romans radiophoniques quotidiens qu’elle suivait religieusement. L’un des titres de ses émissions favorites était: «Jeunesse Dorée». Ces histoires étaient radiodiffusées au début de l’après-midi.
Les nouvelles avaient une importance capitale pour nos parents. Avant son décès, notre père tendait religieusement l’oreille à ce qui se passait dans le monde. Il n’hésitait pas à donner ses commentaires et à discuter de l’actualité. Son attention se portait surtout sur les événements politiques. Alors il s’enflammait et n’hésitait pas à envoyer en enfer les libéraux, car lui était conservateur. Notre père était bleu et rejetait tout ce qui s’approchait du rouge. Comme bon nombre de ses compatriotes, Eugène était l’homme d’un parti comme d’une religion; il ne pouvait en changer. Alors, nous avons eu une initiation politique assez partisane et enflammée, mais quand même utile pour nous qui devons vivre les hauts et les bas de la politique inchangée depuis.
La lecture était chose normale à la maison: Le Soleil, journal venant de Québec, nous était livré par la poste une fois par semaine. Évidemment, c’était loin et les nouvelles n’étaient pas toujours fraîches, mais au moins on était au courant de l’actualité. Le hockey intéressait déjà notre père et les plus vieux de nos frères; les joueurs du Canadien étaient des idoles, même sur la Côte-Nord. Le Bulletin des Agriculteurs qui fournissait les dernières nouvelles concernant la culture de la terre, nous parvenait tous les mois. Cette revue a fait notre initiation aux bandes dessinées: «Onésime et Zénoïde». Huguette avait rapporté un jour, d’une maison où elle travaillait, une bande dessinée de Tintin, intitulée «Tintin en Amérique». Je ne fus certainement pas le seul à le lire et le relire des dizaines de fois. Quelle découverte d’allier l’image au texte! Je ne passerai pas sous silence les nombreuses revues religieuses qu’Antoinette recevait régulièrement et qui éveillaient notre curiosité. Les livres de Félix Leclerc étaient présents aussi dans notre frêle bibliothèque.
J’ai toujours été impressionné par la facilité de notre mère à dessiner les choses. Un jour, assise à table, elle se mit à reproduire au crayon un dessin imprimé sur une enveloppe de pain. En un tour de main, elle réussit à copier intégralement l’original. Rempli de surprise et d’admiration pour une telle facilité, j’essayai la même chose. Je fus des plus agréablement étonné de réussir la même esquisse. Cette petite anecdote fut le début de mon intérêt pour la peinture et le dessin. La peinture à numéro réalisée par Marcel me faisait rêver de tableaux et d’œuvres de toutes sortes. Malheureusement, nous n’avions pas tous les outils nécessaires à la création artistique au cours de cette période.
Je me souviens aussi combien les histoires que maman nous racontait réussissaient à meubler notre imaginaire. Nous n’en finissions pas de lui en redemander, ce qu’elle faisait volontiers. L’école complétait cette éducation culturelle qui s’avéra des plus satisfaisantes malgré les difficultés du temps.